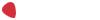- #11
- Publié par
SUNNO le 28 Déc 2004, 12:39
Le riff
Un autre point important permettant d'intégrer la musique métal parmi les autres musique actuelles amplifiées issues du rock est la notion de riff. Celle-ci est définie par Allan Moore comme une “idée simple destinée à être répétée”.
D’abord utilisé en Jazz comme technique d’orchestration ou comme matériau de composition (nous pensons notamment à « Thriving from a Riff » de Charlie Parker où le titre, « Florissant sur un riff », nous explique bien la démarche de composition), le riff s’est rapidement appliqué au Rhythm and Blues puis au Rock. Pour s’inscrire dans une continuité, nous notons aussi une parenté partielle entre la récente notion du sample et celle, plus historique, du riff.
L’idée de riff a donc « glissé » des instruments à vent à la guitare électrique, voire pourquoi pas aux machines, sans perdre son rôle d’élément moteur, soit de l’arrangement, soit du morceau lui-même. Il peut même devenir l’idée globale que l’auditeur retient d’un morceau : le riff d'introduction du « Smoke on the water » du groupe Deep Purple, même joué une seule fois, fait dorénavant partie des clichés du Hard Rock et de la mémoire collective comme peut l’être le début de la cinquième symphonie de Ludwig Van Beethoven.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons dire qu’un riff, si complexe soit-il mélodiquement, est d’abord d’essence rythmique. En effet, que ce soit avec le Jazz, le Rock, ou les musiques Techno, le riff est toujours lié, dans un premier temps, à une tradition de musique dansée. De plus, un sample ou une mélodie, voire juste une note de guitare, n’ont pas obligatoirement de potentiel rythmique intéressant quand on ne les joue qu’une seule fois. C’est la répétition qui va apporter d’abord une certaine légitimité mais aussi un rythme, puisque qu’elle va créer un cycle - nous pouvons aussi noter que cette répétition va induire un certain mode au sens large (échelle de hauteurs, voire de sons).
Le riff est donc une notion éloignée de l’idée classique du thème ; en revanche, il s’approche de celle du motif, et de la basse obstinée. Les mondes des musiques rock et « répétitives » ont d’ailleurs étroitement travaillé ensemble (nous pensons de façon non exhaustive à Brian Eno, Philip Glass ou Steve Reich), et contribué à effacer les frontières entre musiques savantes et populaires dans la deuxième moitié du vingtième siècle, se redéfinissant dans une esthétique post-moderne. Ainsi, la brève explication de légitimité du riff par la répétition pourrait aussi valoir pour les expériences électroacoustiques de Steve Reich telles « It’s gonna rain », où un fragment de phrase enregistré est répété et retravaillé durant vingt minutes.
Certes, même répétés indéfiniment de la même manière (par un instrument ou, encore plus fidèlement, par l’électronique), un sample, un motif, un riff, sont perçus différemment au cours du temps et selon l'auditeur, pouvant faire danser d’abord, bercer, puis énerver. Pourtant, le compositeur du morceau intervient toujours à un moment donné, ne serait-ce que dans le départ et la fin de la répétition, et la manière de le faire (rupture abrupte, fade out, c’est-à-dire decrescendo artificiel de studio). Que ce soit dans un morceau de Métal ou dans un des quatuor à cordes de Philip Glass, la matière première est ensuite travaillée, remodelée. Le libre arbitre du compositeur s’affirme dès le choix préalable du motif pour un potentiel quelconque, puis intervient le travail de composition, c’est-à-dire transformer et structurer les idées de départ.
Plus spécifiquement, la composition en Rock et en Métal reste assez collective et interactive puisqu'elle utilise peu la notation, au contraire des musiques européennes traditionnellement écrites, du Jazz actuel, dont les musiciens sont la plupart du temps lecteurs et improvisateurs, et de la musique électronique, qui est un système d’écriture « obligé » par l’enregistrement. Cependant, cette dernière technique d’écriture par l’utilisation du studio et de l’informatique comme outil de composition prend aussi une part importante dans le travail de nombreux groupes. Ces nouvelles aides à la composition sont particulièrement adaptées à la notion de riff et à la gestion du temps et de la structure. C'est alors une méthode d'écriture simple d'accès, mais surtout très consciente pour qui veut la mettre au service d'une sensibilité personnelle.
-------------------------------------------------------------------
Le solo est une plage improvisée qui présente un intérêt d’analyse sur le plan de sa construction, de la recherche sonore etc. Le solo est souvent la seule différence évidente entre la version enregistrée d’un morceau et celle du concert. Très souvent situé vers le milieu du morceau, il fait contraste ou commente la ligne directrice1 qu’est la voix.