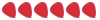http://www.matthieu-metzger.fr.st
Musique Métal
Le Métal, tout comme la majorité des musiques populaires du vingtième siècle, est fortement lié à l'industrie du disque dans le sens où celle-ci impose son standard en matière de support matériel, de durée, de sonorité, de production. Si le Rock'n Roll est né dans les années cinquante avec l'essor de l'industrie phonographique, le Métal est arrivé plus tard, et fort de l'expérience du Rock.
Le rapport de l'auditeur à l'enregistrement s'est d'ailleurs inversé avec l'essor de ce dernier : comme dans beaucoup de domaines, c'est désormais un modèle « à l'américaine » qui régit la production phonographique mondiale. En effet, étant donné la mondialisation des marchés, y compris celui de la musique, on achète désormais un disque pour ensuite, éventuellement, aller écouter l'artiste en concert. Dans un premier temps, la réputation d'un groupe ne se forge plus grâce à sa prestation scénique et vivante.
L'autre aspect du milieu métal, c'est-à-dire l'échange d'enregistrements pirates, de copies, et de démos de groupes locaux, profite aussi de la démocratisation des outils de l'industrie musicale, notamment informatiques et de communication, pour s'auto-produire. Les documents qui nous ont permis, préalablement à l'analyse musicale, de comprendre un tant soit peu le(s) mouvement(s) métal, les esthétiques et les éventuelles idées à la base de celles-ci, sont d'ailleurs principalement tirés de l'Internet. Il s'agit du guide
www.allmusic.com, la
chronologie d'Éric Lestrade, et l'inégale compilation de « Spinoza Ray Prozac » issue du provocant
www.anus.com.
Histoire
L'expression “Heavy Metal” apparaît pour la première fois dans la nouvelle Nova Express de William S. Burroughs où l'auteur dépeint une société fictive de haute technologie et de négation de l'humain. Elle est utilisée à la même époque dans la chanson Born to be Wild du groupe Steppenwolf. Ses paroles résument l'ambiguïté entre la violence, la peur, et la paradoxale attirance pour celles-ci :
I like smoke and lightning
Heavy Metal thunder
Racing with wind
And the feeling that I'm under
L'histoire du Métal depuis ses origines donne une impression globale de questions-réponses entre la vieille Europe, principalement l'Angleterre (mais aussi la Scandinavie, l'Allemagne), et les États-Unis. En effet, la naissance des courants principaux s'opère toujours par réaction à un aspect trop brut et violent de la musique ou, au contraire, trop populaire et trop commercial. Dans le premier cas, le Métal, de par son caractère rock « universel » s'adapte aux particularismes locaux (comme dans la musique du groupe Sepultura par exemple), se métisse, ou s'assagit, se popularise et se commercialise mieux. Dans le second, un retour s'opère aux bases du Heavy Metal, qui revêt un caractère toujours plus violent, comme pour la naissance du Black Metal ou du Death Metal.
A partir de l'après deuxième guerre mondiale, le Rock, de langue anglaise et de culture américaine, s'exporte. Né avec les enfants du baby-boom, il est un genre musical en devenir apprécié universellement. Il est donc naturel que deux groupes anglophones de la fin des années soixante soient à l'origine du Métal.
Le groupe anglais Led Zeppelin annonce premièrement la musique hard rock (littéralement « rock dur »). Ce groupe issu des Yardbirds joue à l'origine du Blues-Rock. Jimmy Page, guitariste et John Paul Jones, bassiste sont déjà, avant la formation du groupe, des musiciens de studio reconnus. Led Zeppelin va tout de suite s'orienter vers un style parfois nommé « Heavy Blues » étant donné la violence de l'interprétation. Au-delà de la musicalité et des influences du groupe, c'est la puissance de la batterie, de la guitare et de la distorsion, la voix parfois criée et suraiguë de Robert Plant qui ouvrent le chemin aux musiques plus extrêmes. Il existe certes des différences entre le Hard Rock et le Métal (notamment en ce qui concerne la technique de chant, qui peut définir à elle seule un des sous-genres de ces musiques), mais les deux vont par la suite beaucoup s'influencer pour finalement être difficile à séparer.
Il nous faut noter que Led Zeppelin a aussi eu beaucoup d'importance en terme économique, social et d'image. Outre les « on-dit » sur les penchants pour l'occultisme de certains de ses membres, cette musique est aussi liée à la démesure des tournées mondiales, des shows durant parfois plus de trois heures, et des profits engendrés.
Le deuxième groupe, également anglais, “moins subtile, mais plus déterminant” comme le décrit le guide
www.allmusic.com, est Black Sabbath, groupe de Blues-Rock à l'origine, et passionné par l'occulte et l'effet des drogues. La voix reste chantée (même si elle sonne « poussée ») et le jeu instrumental doit aussi beaucoup au Blues-Rock de l'époque, avec cependant une sonorité de guitare plus saturée, plus distordue10. Cette naissance du Heavy Metal se déroule parallèlement avec la fin de la musique psychédélique et le début du Rock progressif, catégories avec lesquelles le nouveau genre peut alors être un peu confondu.
Aux États-Unis, le courant apparaît sous une forme plus accessible et spectaculaire, avec des groupes comme Alice Cooper, Kiss, Aerosmith, Van Halen, AC/DC. La réaction du vieux continent au milieu de la décennie 70 est une sorte de retour aux sources avec la naissance d'une musique plus rapide et plus menaçante : la New Wave of British Heavy Metal (avec notamment les groupes Judas Priest, Iron Maiden, Motörhead). Celle-ci influence elle-même la naissance du courant thrash dans les années 80, allant à l'encontre d'une nouvelle dérive pop du genre qui commence à entrer dans les classements de ventes. Le Thrash Metal (appelé aussi Speed Metal par certains) est rapide, à l'écriture complexe, très technique instrumentalement, parfois mélodique, et s'inspire aussi du mouvement hardcore / punk (lui-même anglais). Les meilleurs représentants du genre ont pour nom Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeath. Si nous considérons la musique métal comme un signal d'alarme social, cette surenchère de technique et de violence peut aussi être une réaction par rapport à l'« American Way Of Life » et la société de consommation de l'époque.
A partir des années quatre-vingt-dix, le Métal s'ouvre à de nouvelles influences à l'image de l'évolution post-moderne de nos sociétés : le courant grunge, les influences hip-hop, la musique électronique viennent s'y mêler. Le son rock et distordu, l'important volume sonore, le côté spectaculaire de la musique sont rentrés dans les moeurs mondiales. L'omniprésence des médias permet à ceux-ci de tirer parti du potentiel économique de cette musique de plus en plus populaire, ce qui influe en retour sur la création musicale et l'appréhension de cette partie visible du milieu Métal par le grand public. De plus, l'évolution technologique permet la démocratisation d'outils d'enregistrement de qualité, et d'auto-promotion avec l'Internet principalement.
Dans le même temps, le côté underground du Métal (authentique ou puriste selon les visions), même s'il peut bénéficier d'une manière ou d'une autre de la notoriété de groupes plus sages et plus commerciaux, se durcit. Deux styles dérivés du Thrash, encore plus rapides et plus violents, émergent : Death Metal et Black Metal13, ainsi que plusieurs autres de façon locale d'abord.
Nous voyons donc que la musique métal est une forme de musique violente très récente issue de Blues et du Rock, et qui a considérablement évoluée en trois décennies. Accumulant les influences, elle a aussi engendré une multitude de sous-genres partout dans le monde, ce que nous montre le tableau d'Éric Lestrade.
Figure 1 : Chronologie de la musique métal d'Éric Lestrade
http://www.multimania.com/ericlestrade
Idées
Né d'un Blues-Rock confronté à l'essor de l'amplification électrique à laquelle ont largement contribué The Who, Jimi Hendrix, ou Cream par exemple, le Heavy Metal n'est pas coupé de la musique rock. Il en est une forme spéciale, “la plus extrême en volume, en violence, en théâtralité, et parfois dans l'idéologie même”. S'il a toujours pu être controversé et considéré comme une musique pour adolescents ou un refuge musical pour satanistes, le Métal conserve une certaine constance, a généré beaucoup de styles, et possède un fort potentiel underground, car il est une musique volontaire : les premières preuves en sont la multitude de concerts amateurs ou pas, le relatif bénévolat des musiciens (surtout dans le courant Hardcore), et la démarche de fans qui diffusent les informations et les tracts.
“Mon unique propos a toujours été de m'exprimer.” Cette phrase de Paul Stanley, membre de Kiss, telle que nous la donne Spinoza Ray Prozac, résume parfaitement le côté hédoniste des musiques Hard Rock et Métal. Il se ressent dans leur aspect scénique, où l'hédonisme est mode d'expression de lui-même. Le volume sonore important, l'expression tribale des percussions, la « lourdeur » du son créent un rapport tellurique à la réalité. La définition que Spinoza Ray Prozac nous donne du Métal, d'un point de vue philosophique, est claire et convenable : un nihilisme existentialiste. En outre, le parallèle avec la philosophie de Nietzsche, notamment avec les notions de surhomme, de volonté de puissance, est possible mais relatif.
D'un point de vue social, le Métal peut être considéré comme une contre-culture, une réaction apolitique contre un système, et comparé à la musique punk en tant que signal d'alarme. Nous pouvons aussi y retrouver des valeurs proches de celles d'un romantisme désabusé (vision nihiliste du monde), introspectif, aux sentiments exacerbés et fasciné par une mort salvatrice. Techniques musicales mises à part, il n'est pas impossible d'établir des correspondances avec les univers désabusés de Schubert, Schumann, des poètes qui les ont influencés, ou de l'expressionnisme allemand.
Cette musique est fascinée par le chaos, la mort et la souffrance, omniprésents dans les textes et les compositions même. En plusieurs points, elle s'oppose à une société occidentale qui a basé ses principes sociaux, individuels et mystiques sur une vision judéo-chrétienne du monde, la polarité du bien et du mal, le tabou de l'enfer, etc. Socialement, le Métal possède alors une nouvelle “image attractive [et structurante] pour des légions de jeunes de banlieues désabusés”. La rupture avec la société n'est évidemment pas totale, étant donné que cette contre-culture, “méthode d'examen de la peur et du désespoir” comme la définit Spinoza Ray Prozac, a pour armes les outils de composition occidentaux et l'instrumentation du Rock. Le Métal puise sa force dans l'ambiguïté : chaos sonore et précision rythmique, folie destructrice et rédemption. Elle ne peut être considérée ni comme une agression apocalyptique, ni comme une complète catharsis.
Satanisme et Occultisme
L'intérêt pour les choses occultes et le « culte de Satan » a toujours été lié à l'image du Métal (genre lointainement issu du Blues, lui-même déjà décrit comme une musique du diable dès ses origines). En effet elle correspond parfaitement à l'idée de violence, de puissance de cette musique. Il faut néanmoins ne pas faire d'amalgame : si tous les groupes de cette esthétique ont forcément un jour été confronté à ces d'idées, beaucoup ne s'y sont pas assez intéressés pour influencer leur mode de vie. Les thèmes occultes ont aussi contribué à une sorte d'introspection culturelle, et le plus souvent bâti l'image du « méchant métalleux » avant de servir des idées. Il faut aussi savoir que la prétendue Église Satanique aux États-Unis a d'abord été une mode à laquelle ont contribué Led Zeppelin mais aussi des formations à l'esthétique bien moins extrême tels les Eagles, ou les Beatles.
Même en étant en total désaccord avec de tels agissements, il faut admettre ce passé comme constituant de la musique Métal moderne, et assurément faire la part des choses entre l’idéologie des textes et de la mise en scène (la promotion démesurée en est déjà une), la simple mode, qui est devenue presque un fond de commerce chez certains des anciens très assagis, et le fait musical. Les messages explicites d'appel à la violence ou au satanisme sont rares voire inexistants. Le Satanisme est représentatif du Métal dans le sens où il est un enjeu politique : c’est alors une simple dérive du nihilisme, une réponse à la morale chrétienne ancrée dans la culture occidentale et encore liée à la politique, notamment aux États-Unis.
Violence contre Puissance
La musique métal revêt de par sa nature un aspect violent, voire très violent, lié comme nous l'avons vu à des idéologies, des contextes sociaux. Elle révèle sûrement un aspect masochiste du public et de l’être humain plus généralement. Nous y trouvons une volonté de destruction par la saturation, un volume sonore du moins incroyable sinon insensé, des évènements de masse qui sont une négation du « moi » dans la foule et les décibels.
Cette manière occidentale d'appréhender la musique vivante (c'est-à-dire assister de façon passive à un spectacle) y côtoie cependant un aspect social fort. La notion de slam, où un spectateur tout à fait anonyme monte sur scène et saute dans une foule qui va le porter et le faire voyager dans la salle, au-dessus d'elle, en est une bonne preuve. Le Métal peut alors être comparé à une sorte de communion dans une agression sonore enveloppante. Cette musique d'énergie reste fortement liée au corps et sa résonance, dansé. Les enjeux de la production sonore, la rapidité d'exécution, la puissance sonore (comme pour la caisse claire de Tomas Haake, batteur de Meshuggah, qui est puissante mais pas agressive), la bonne sonorisation et le réglage précis du matériel sont autant de preuves d'une volonté de puissance et de perfection.
Popularisation
Pour Spinoza Ray Prozac, l'influence musicale du Métal et de la culture métal sont des “indicateurs de pénétration des idées dans la culture mondiale au moins inconsciemment, où le symbolisme, l'esthétique et la nature communicative de la structure comme métaphore du Métal en tant qu'art fait effet”. Nous observons un phénomène de mode depuis quelques années avec des groupes tels Incubus, Korn au niveau mondial, ou Pleymo en France. Celui-ci n'est-il pas un moyen pour les sociétés occidentales d'absorber une rebellion comme elle a pu le faire auparavant, par la commercialisation à grande échelle qui engendre une banalisation de l'objet et la mise en avant de la forme au détriment du fond ? Ainsi, Ozzy Osbourne, membre fondateur de Black Sabbath, possède aussi sa facette de promoteur de la musique métal avec la OzzFest (tournées et festivals aux États-Unis et dans le reste du monde), et accessoirement de héros d'une série-fiction très populaire sur la famille Osbourne.
Sonorités particulières et composition par riff
Quelle que soit sa qualité ou son authenticité, c'est par sa sonorité singulière que le grand public peut identifier le Métal de prime abord. En effet, si l'on joue une chanson de Jacques Brel sur une guitare au son distordu, ou une fugue de Jean-Sébastien Bach (ce à quoi nombre de guitaristes électriques virtuoses se sont adonné), on dira communément que c'est une version « trash », « hardcore », voire «bourrin », termes très flous mais renvoyant à un style de musique particulier. En revanche, si l'on fait jouer de la musique métal par un claveciniste, une oreille non avertie n'y entendrait pas de référence directe. Tout au plus, l’aspect rythmique du morceau serait-il exacerbé.
Il existe dans cette esthétique sonore une réelle volonté de puissance et / ou de violence, et la limite entre ces deux états s'avère souvent difficile à trouver.
L'agression sonore dans ce cas est tout d'abord une manière de s'exprimer et de se faire entendre, une sorte de happening sonore où le public ne peut échapper à la musique. Même si nous ne pouvons nier le potentiel de violence de cette musique, il s'agit plus souvent d'une sorte de communion avec le public dans la matière sonore omniprésente, où le lien entre musicien et spectateur semble rester très digne.
D'autre part, les amateurs de musiques amplifiées parlent volontiers de « gros son » lorsque celui-ci est fort mais bien géré et plaisant. La recherche d'un volume sonore à la limite du concevable en termes de dangers auditifs2, et celle d'un son de plus en plus percussif et présent peuvent être vues comme une continuité de la facture instrumentale purement acoustique. Les techniques décrites ici sont des lieux communs pour un « métalleux »3, et n'ont pas toutes été développées dans la musique métal, mais s'inscrivent dans une certaine logique de ce qui est communément appelé la production. Comme pour toutes les musiques amplifiées telles le Rap, la variété, le Rock ou la Techno, l'augmentation du volume sonore, et notamment des fréquences basses, fait systématiquement entrer un nouveau paramètre, celui de la résonance du corps humain, lié aussi au fait que le Métal reste une musique populaire dansée.
Que ce soit pour la voix, les guitares ou la batterie, nous retrouvons les techniques de traitement du signal dans toutes les musiques populaires amplifiées, à plus ou moins grande échelle. Néanmoins, la production du son est inhérente à cette musique (exigences de volume sonore, instruments nécessairement amplifiés, traitement du signal), d'où la nécessité de faire un tour d'horizon des outils employés. Très éloignées de la notion de musique vivante d'il n'y a pas même un siècle, ces outils et techniques sont à assimiler tels une sorte de postulat de départ pour comprendre la plupart des nouveaux courants musicaux.
Percussions
La sonorité Métal est reconnaissable par son instrumentation et le traitement du son inhérent à cette musique. La batterie, tout d'abord, doit être la plus percussive possible. Ce son est obtenu soit en tendant suffisamment les peaux des toms et de la grosse caisse puis en étouffant les résonances grâce à du tissu ou des gommes spéciales, soit en détendant à l’extrême les peaux pour éviter cette résonance et obtenir une attaque puissante. C'est ici une manière de préparer la percussion devenue presque systématique dans cette musique. Le volume sonore global étant très élevé, les amplificateurs des guitares peuvent facilement couvrir le son de la batterie ; celle-ci doit donc être sonorisée aussi. Dans le même ordre d'idée que la préparation physique, et que ce soit pour un concert ou un enregistrement, la résonance naturelle provenant de chaque fût est parfois tronquée, c'est à dire qu’un noise gate4 est appliqué sur la piste de la table de mixage correspondant au microphone de l'élément de batterie.
Il en découle que l'auditeur n'entend qu'un élément sonore significatif de l'instrument de percussion, ce qui le définit en premier lieu, c'est-à-dire l'attaque. Ce procédé a aussi son explication pratique, car sur une scène au volume sonore important, toute résonance trop longue (comme cela peut être le cas dans un fût) peut faire « tourner » le son jusqu'à l'effet larsen37. Dans la plupart des cas, le son coupé de sa résonance est alors compressé37.
Le noise gate peut aussi être appliqué à la grosse caisse et à la caisse claire, quoique la caisse claire reste parfois un des éléments de la batterie utilisé en nuances. La compression bien gérée sur chaque élément donne l'impression de « gonfler » le son et de le rendre plus net, lui permet d'être plus fort et plus continu dans le cas d'attaques puissantes. Nous voyons donc qu'il n'y a plus de volonté de reproduire le son exact d'un instrument : l'intention est ici de vraiment modeler le son à sa manière, par tous les moyens possibles pour pouvoir le rendre plus fort, encore plus présent dans une logique d'agression sonore. Ainsi, pour éviter l'apparition d'effets larsen, de problèmes d'acoustique de salle, de variation dans l'attaque, le trigger est parfois utilisé. Des capteurs réagissent à l'attaque de la baguette sur la peau, et la transmettent à un appareil capable de traduire cette impulsion, qui va à son tour déclencher un son pré-enregistré (à l'aide d'un échantillonneur37, permettant d'enregistrer et modifier le son désiré, ou une banque de sons prédéfinis par le constructeur). Cela permet d'obtenir le meilleur rendu possible dans n'importe quelle condition d'enregistrement ou de sonorisation. En complément, et mixé moins fort, le vrai son du micro peut être ajouté pour garder les subtilités du son naturel et du jeu du batteur, mais celui-ci n'est pas prépondérant dans le rendu final du son de batterie. L'instrument reste le même sur scène pour des convenances visuelles, mais ce n'est pas par exemple le son de la grosse caisse que l'on entendra - ou presque pas - mais un son de grosse caisse « idéal ». Il peut en être de même pour les toms, la caisse claire. Il y a un indéniable effet d'illusion entre ce que l'on voit sur scène et ce qui en résulte, illusion de la production sonore inhérente à la préparation des instruments.
Dans le cas de Meshuggah, la sonorité de la batterie provient du fait qu'elle est enregistrée de manière acoustique, exception faite pour la caisse claire dans les albums Destroy Erase Improve et Chaosphere, qui elle est échantillonnée5 et très mécanique. Le son acoustique de la grosse caisse, puissante et rapide grâce à l'usage courant en Métal d'une pédale à chaque pied, est retravaillé pour n'en conserver que l'attaque naturelle, peu de résonance, et plus ou moins de fréquences graves selon les albums. Ce son de grosse caisse convient au jeu homorythmique avec la basse et les guitares qui prennent une grande partie du spectre grave, surtout dans Nothing. Ainsi le claquant de la grosse caisse vient compléter l'attaque et les graves des guitares - nous dirions même « le gras » dans ce cas .)
Nous avons donc ici une façon particulière d'envisager la batterie traditionnelle, à l'opposée de l'esthétique jazz, où les nuances (mais pas forcément la subtilité) existent moins. L’esthétique sonore seule est en corrélation avec l’esthétique musicale : une forme d'agression, de violence sans compromis. L'équilibre entre les instruments est totalement artificiel, et géré par l'ingénieur du son. Chaque événement, qu'il soit constitué d'un son (une cymbale, un cri, une note d'un solo) ou de plusieurs comme c'est plus souvent le cas, doit ressortir pour être entendu.
Guitare et basse. La distorsion
“Depuis les débuts du Métal, le power-chord a été l'accord de base dans les riffs6 de Métal”. Si le power-chord, que nous appellerons « accord de puissance » consiste dans sa plus simple expression, en une quinte juste, ce n'est donc pas un accord au vrai sens du terme. Certains guitaristes le jouent avec juste les deux notes, d'autres avec trois (fondamentale, quinte, octave), et encore d'autres, avec quatre notes (fondamentale et quinte en deux octaves). Il existe aussi un renversement de l'accord de puissance de base, qui est la quarte juste à vide. Souvent utilisé en alternance avec la disposition de base, permettant ainsi des successions plus fluides à la guitare, il possède sa propre couleur changeante selon le nombre de cordes jouées (donc de notes doublées).
Nous voyons donc que l'accord de puissance est axé sur sa fondamentale, et qu'il est en définitive une seule note dont le spectre serait modifié (par l'adjonction de la quinte, et la doublure à l'octave), ce que Espen T. Hangård8 explique très bien : “L' accord de puissance n'est pas utilisé dans un contexte harmonique, mais son usage est plutôt lié à la sonorité qu'il génère. Quand l'amplificateur sature [ce que l'on simule et retravaille grâce aux effets de distorsion], l'intervalle consonant [qu'est la quinte ou dans une mesure moindre la quarte] génère un son plein, clair.”
Le terme distorsion, qui renvoie à la distorsion d'un signal en physique, désigne dans ce contexte un signal saturé (implicitement « distordu jusqu'à la saturation ») de façon plus ou moins linéaire9. Nous pouvons nous représenter la saturation grâce à la membrane d'un haut-parleur, premier générateur sonore de distorsion : le signal sature lorsque celle-ci ne peut plus soit avancer, soit reculer. Il en résulte donc une forme d'onde qui se rapproche de plus en plus d'un signal carré au fur et à mesure qu'on fait saturer le haut-parleur par augmentation du volume, ou par simulation de cette saturation. Or un signal carré pur est la somme d'une fondamentale et de tous ses partiels (dont le volume est exponentiellement décroissant selon l'harmonique). Cela donne à la fondamentale un spectre harmonique artificiel. Ce spectre aigu est en d'autres termes un signal distordu de la fondamentale. Il faut ajouter que les harmoniques naturelles de la corde et les bruits parasites, dont l'attaque, prépondérants dans la sonorité d'un l'instrument, sont saturés avec le reste. Ces autres paramètres du son sont beaucoup moins présents qu'une fondamentale, mais ils en définissent aussi le timbre, et de par ce fait, la chaleur naturelle qui va rester même après la distorsion. Si celle-ci fait se rapprocher le son d'un signal carré, ce dernier restera toujours beaucoup plus pauvre qu'un son de guitare distordu, ce qui explique qu'un guitariste de Métal reste très regardant sur la sonorité naturelle de sa guitare autant que sur le traitement du son.
En outre, trop de dissonances ou trop de saturation créent un son trouble. Le terme dissonance est ici utilisé dans un contexte un peu différent du langage classique. Plus l'intervalle est simple (rapport d’octave, quinte, quarte), plus la distorsion crée un son fondamental auquel des harmoniques sont ajoutées. Nous pouvons donc envisager le couple accord de puissance / distorsion comme un traitement sonore « à la base ». Les intervalles de triton, seconde, tierces, leurs renversements, et plus généralement, les rapports de fréquences complexes, créent un son brouillé perçu à l'audition comme un bloc compact d'où n'émerge aucune fondamentale précise. Les intervalles et accords plus fournis sont réservés à des parties en clean c'est-à-dire sans distorsion, ou alors sont utilisés comme bruitage, dans un but bien précis et occasionnel10.
La distorsion peut donc être perçue comme une volonté de clarté et de plénitude sonore. L'accord de puissance et la distorsion constituent ainsi deux techniques complémentaires. Elle sont utilisées très différemment selon les courants issus du Rock ou même du Métal : staccato en aller simples ou aller-retour de la main, nombre de cordes variable, distortion criarde ou sourde, très propre ou très sale etc.
Il découle des principes de cette interaction entre jeu de l'instrument et traitement du son. “Même si une chanson de Métal suit plus ou moins une tonalité définie [ou peut-être devrions nous dire un mode défini, ou seulement une réminiscence tonale], la quinte de l'accord de puissance est toujours une quinte juste, et n'est pas nécessairement altérée pour respecter l'échelle [ce qui implique alors un mode, une échelle, mais aussi, dès le départ, des notes situées entre la note étrangère et la résonance naturelle].” Espen T. Hangård12 prend l'exemple d'un Fa dièse en Sol majeur, dont la quinte restera Do dièse au-delà des convenances tonales que les musiciens de Métal ont pourtant bien dans l'oreille de par leur culture occidentale. L'accord de puissance est ainsi utilisé comme une entité sonore pour ses qualités de puissance et de timbre. La basse y complète le spectre des guitares et assure à l'accord de puissance la prédominance d'une note fondamentale. Pour ce faire, la plupart du temps, elle double une corde du riff à l'octave inférieure (puisque la basse électrique, tout comme la contrebasse, sonne naturellement une octave en dessous de la guitare).
Voix
Le fait que la musique métal et ses différents courants se reconnaissent à leur sonorité tient aussi au chant. En effet la musique rock, dans sa grande majorité, est restée fidèle à la chanson, peut-être en raison de son caractère populaire. La voix y subsiste en tant qu'élément humain, concret13, lien privilégié pour l'auditeur qui n'est pas obligatoirement connaisseur. C'est alors le timbre de la voix qui prime sur le texte, ce qui peut expliquer d'une part le désintérêt pour celui-ci, voire l'absence de paroles définies chez certains groupes, et parfois leur inintelligibilité d'autre part.
Presque tous les sous-genres de la musique métal utilisent la voix criée. Ce chant guttural consiste succinctement en une saturation artificielle de la voix. Si la plupart de ces voix ont un volume sonore puissant, ce n'est pas le cas pour toutes : le but est d'obtenir, de maîtriser, et de travailler le timbre d'un cri sans les inconvénients (détérioration des cordes vocales notamment). Cette voix artificiellement criée est alors obtenue par une contraction du larynx conjuguée à la propulsion d'un débit d'air important.
Si nous considérons l'esthétique et la puissance sonore de la musique métal, le cri semble presque être un cap obligé dans l'évolution rapide de l'amplification qu'a connu le vingtième siècle. La voix criée est devenue un standard de chant, preuve qu'elle a suscité l'intérêt et a été maîtrisée. Utilisée comme élément musical ponctuel dans la plupart des musiques, dont la musique rock, la voix criée a été systématisée par la musique métal, et de beaucoup de manières différentes. Si pour un néophyte tous ces chants se ressemblent16, il existe des voix plus ou moins chantées (chez les groupe Fear Factory ou Dream Theater), plus ou moins parlées (Type O Negative), criées (Meshuggah), très graves (Cannibal Corpse) ou aiguës (Craddle of Filth), qui définissent parfois presque à elles seules un style. Il faut ajouter à cette liste tous les codes et tics de dictions ainsi que les différents traitements sonores couramment utilisés.
Les enjeux esthétiques d'une telle technique de chant se rapprochent de la distortion, dénaturant la voix en lui ajoutant un grand nombre d'irrégularités et d'harmoniques artificielles. Il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre parler de « son clair » pour les parties de voix chantées de manière plus classique. Symboliquement, le cri est aussi la technique vocale la plus à même d'exprimer la vision de la vie, le nihilisme inhérent à la musique (ou du moins ses bases). Il est donc naturel qu'il se soit développé avec celle-ci. La voix est peut-être la preuve la plus évidente de la catharsis de la musique métal : représenter les passions pour mieux s'en séparer.
Enfin, s'il est vrai que le texte chanté n'est généralement pas intelligible en raison du timbre particulier de la voix, nous pouvons comparer cet inconvénient de la voix gutturale à celui d'une voix d'opéra vibrée dont ne sortiront plus que des voyelles noyées : dans les deux cas, ce n'est qu'après plusieurs écoutes, ou étude du texte que l'auditeur peut en saisir toute la signification.
Le riff
Un autre point important permettant d'intégrer la musique métal parmi les autres musique actuelles amplifiées issues du rock est la notion de riff. Celle-ci est définie par Allan Moore comme une “idée simple destinée à être répétée”. D’abord utilisé en Jazz comme technique d’orchestration ou comme matériau de composition (nous pensons notamment à « Thriving from a Riff » de Charlie Parker où le titre, « Florissant sur un riff », nous explique bien la démarche de composition), le riff s’est rapidement appliqué au Rhythm and Blues puis au Rock. Pour s’inscrire dans une continuité, nous notons aussi une parenté partielle entre la récente notion du sample (échantillon) et celle, plus historique, du riff.
L’idée de riff a donc « glissé » des instruments à vent à la guitare électrique, voire pourquoi pas aux machines, sans perdre son rôle d’élément moteur, soit de l’arrangement, soit du morceau lui-même. Il peut même devenir l’idée globale que l’auditeur retient d’un morceau : le riff d'introduction du « Smoke on the water » du groupe Deep Purple, même joué une seule fois, fait dorénavant partie des clichés du Hard Rock et de la mémoire collective comme peut l’être le début de la cinquième symphonie de Ludwig Van Beethoven.
Quoi qu’il en soit, nous pouvons dire qu’un riff, si complexe soit-il mélodiquement, est d’abord d’essence rythmique. En effet, que ce soit avec le Jazz, le Rock, ou les musiques Techno, le riff est toujours lié, dans un premier temps, à une tradition de musique dansée. De plus, un sample ou une mélodie, voire juste une note de guitare, n’ont pas obligatoirement de potentiel rythmique intéressant quand on ne les joue qu’une seule fois. C’est la répétition qui va apporter d’abord une certaine légitimité mais aussi un rythme, puisque qu’elle va créer un cycle - nous pouvons aussi noter que cette répétition va induire un certain mode au sens large (échelle de hauteurs, voire de sons).
Le riff est donc une notion éloignée de l’idée classique du thème ; en revanche, il s’approche de celle du motif, et de la basse obstinée. Les mondes des musiques rock et « répétitives » ont d’ailleurs étroitement travaillé ensemble (nous pensons de façon non exhaustive à Brian Eno, Philip Glass ou Steve Reich), et contribué à effacer les frontières entre musiques savantes et populaires dans la deuxième moitié du vingtième siècle, se redéfinissant dans une esthétique post-moderne. Ainsi, la brève explication de légitimité du riff par la répétition pourrait aussi valoir pour les expériences électroacoustiques de Steve Reich telles « It’s gonna rain », où un fragment de phrase enregistré est répété et retravaillé durant vingt minutes. Certes, même répétés indéfiniment de la même manière (par un instrument ou, encore plus fidèlement, par l’électronique), un sample, un motif, un riff, sont perçus différemment au cours du temps et selon l'auditeur, pouvant faire danser d’abord, bercer, puis énerver. Pourtant, le compositeur du morceau intervient toujours à un moment donné, ne serait-ce que dans le départ et la fin de la répétition, et la manière de le faire (rupture abrupte, fade out, c’est-à-dire decrescendo artificiel de studio). Que ce soit dans un morceau de Métal ou dans un des quatuor à cordes de Philip Glass, la matière première est ensuite travaillée, remodelée. Le libre arbitre du compositeur s’affirme dès le choix préalable du motif pour un potentiel quelconque, puis intervient le travail de composition, c’est-à-dire transformer et structurer les idées de départ.
Plus spécifiquement, la composition en Rock et en Métal reste assez collective et interactive puisqu'elle utilise peu la notation, au contraire des musiques européennes traditionnellement écrites, du Jazz actuel, dont les musiciens sont la plupart du temps lecteurs et improvisateurs, et de la musique électronique, qui est un système d’écriture « obligé » par l’enregistrement. Cependant, cette dernière technique d’écriture par l’utilisation du studio et de l’informatique comme outil de composition prend aussi une part importante dans le travail de nombreux groupes. Ces nouvelles aides à la composition sont particulièrement adaptées à la notion de riff et à la gestion du temps et de la structure. C'est alors une méthode d'écriture simple d'accès, mais surtout très consciente pour qui veut la mettre au service d'une sensibilité personnelle.