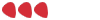Alexandre Delaigue sur son site econoclaste.org a écrit :
le contenu informatif de cette vidéo est assez pauvre. La seule chose que l'on y "découvre", c'est le mécanisme de création monétaire par le crédit, le fait que les banques ne prêtent pas un argent qu'elles "ont dans leur coffre" mais créent par le crédit de la monnaie scripturale. ce mécanisme est présenté comme extraordinaire et dissimulé, ce qui est un peu paradoxal dans la mesure ou il n'est pas difficile à découvrir : il se trouve expliqué dans n'importe quel manuel d'économie, et est au programme de la filière ES (en première me semble-t-il). Pour le reste, la vision qui y est donnée de l'histoire monétaire (l'orfèvre qui découvre qu'il peut prêter de l'argent qu'il n'a pas et devenir très riche) est fausse; les mécanismes monétaires sont présentés de façon incomplète (le fait que l'extinction d'une dette détruise de la monnaie n'est pas présenté); on y dit qu'une économie sans croissance, ou décroissante, ne comporterait plus de prêt à intérêt (ce qui est historiquement faux : les intérêts n'ont pas disparu durant les phases de croissance négative connues dans l'histoire); il y a d'autres omissions.
Et ces omissions ont un objectif, qui est de faire passer le message politique de l'auteur. Une histoire de la création monétaire devrait montrer que l'émission monétaire est un pouvoir régalien, et que ce pouvoir a souvent mal été utilisé, avec la pratique consistant à réduire le titre en métal précieux des pièces par exemple (l'origine du mot "banque" vient de la tablette sur laquelle les changeurs de monnaie évaluaient le titre en métal des pièces, en les faisant tinter et rouler pour tester leur équilibre, ce qui est à l'origine du terme d'espèces "sonnantes et trébuchantes" : le "banquier", au départ, était celui qui établissait la vérité sur des monnaies trafiquées par les gouvernements les émettant. Comme quoi...). De la même façon, la création de monnaie scripturale n'a pas été une machination des banquiers pour s'enrichir en dupant le public, mais s'est faite par hasard - et parfois sous l'impulsion de gouvernements demandant des prêts toujours plus conséquents. Pour s'apercevoir que l'on crée de la monnaie en émettant des crédits, il faut disposer de la comptabilité en partie double, et pas de la comptabilité de caisse que les banques ont utilisé pendant très longtemps; et faire un raisonnement "macroéconomique" que les banquiers n'avaient aucune raison de faire. De leur point de vue, il s'agissait de récupérer de l'argent métallique que quelqu'un d'autre détenait, et tant que les entrées étaient supérieures aux sorties, tout allait bien; ils n'avaient aucune raison de supposer qu'ils créaient de la monnaie au passage. Enfin, cette vidéo se focalise sur quelques phénomènes monétaires sans préciser les phénomènes réels qui l'accompagnent : après tout, moi aussi, lorsque j'emprunte de l'argent, je dépense un pouvoir d'achat que je n'ai pas. Je dois donc trouver quelqu'un qui va accepter de réduire sa consommation présente, en contrepartie de quoi je réduirai ma consommation future (et la sienne sera plus forte). Sans négliger que les phénomènes monétaires ont de l'importance, il serait bon de rappeler que les transactions monétaires sont avant tout le voile d'échanges réels, et que ce sont ceux-là qui comptent.
Cette vidéo n'apporte pas non plus la moindre explication du phénomène de l'intérêt, présenté simplement comme "lié à la croissance effrenée". Une explication authentiquement pédagogique décrirait la question qu'a posée l'intérêt, le décalage entre son interdiction fréquente par les religions et les tentatives permanentes pour contourner cet interdit. On pourrait par exemple décrire la façon dont Thomas d'Aquin avait résolu le paradoxe d'Aristote, selon lequel le prêt à intérêt relevait de la "chrématistique"; puisqu'on échangeait de l'argent contre de l'argent, il n'y avait eu aucune création de valeur, donc l'intérêt était sans justification. Thomas d'Aquin avait lui décrit les trois fonctions de l'intérêt : il est la rémunération du temps, du fait que le prêteur doit temporairement renoncer à sa consommation; il est la rémunération du risque, parce que l'emprunteur ne remboursera pas forcément: il est enfin "participation aux bénéfices" si l'emprunteur utilise l'argent emprunté pour une entreprise rémunératrice. Pour Saint Thomas, si la première justification n'était pas acceptable (car le temps n'appartient qu'à Dieu) les deux autres légitimaient les intérêts. Au passage, on peut noter que même dans une économie sans croissance, si la dernière justification ne tient plus (faute de bénéfices) les deux autres restent valides. On peut noter aussi que la "finance islamique" a contourné l'obstacle de l'interdit de l'intérêt selon une logique très Thomiste : les banques islamiques ne font pas payer d'intérêts, mais prennent des "participations aux bénéfices" réalisés par leurs emprunteurs.
Bien évidemment, évoquer les millénaires de manipulation du titre en métal des monnaies par les gouvernements jurerait dans le paysage de la vidéo, qui prône un système économique dans lequel toute la création monétaire est monopolisée par le gouvernement, qui l'utilise pour financer ses dépenses; expliquer que cette idée soi-disant révolutionnaire a déjà été largement testée et plutôt peu satisfaisante dans ses conséquences serait contradictoire. C'est que cette vidéo n'a qu'un objectif : promouvoir une vision de la société, proche des idées de la décroissance; et que les contenus réels n'ont d'autre visée que d'être au service de cette volonté de promotion d'une idéologie.
Et parce que ce projet, présenté comme tel, n'aurait probablement pas le succès qu'a eu cette vidéo, il faut l'accompagner en expliquant au spectateur que le monde actuel est le fruit d'un complot; que la réalité de la création monétaire est caché; que l'on pourrait cesser de payer des intérêts (sur de l'argent qui "n'existe pas"...) si seulement la vérité était révélée. Que les intérêts n'ont d'autre vocation que d'enrichir des banquiers parasites et une croissance infinie.