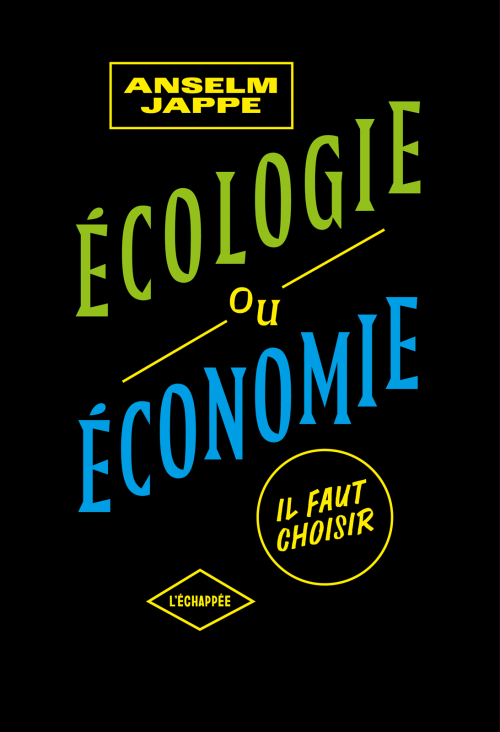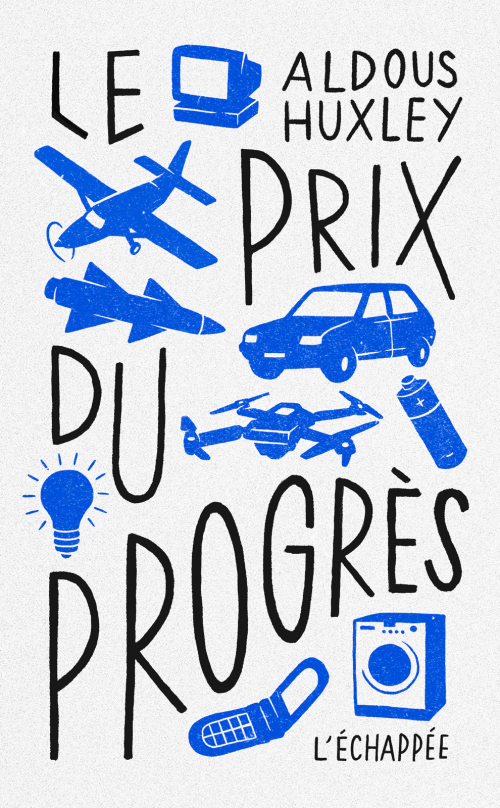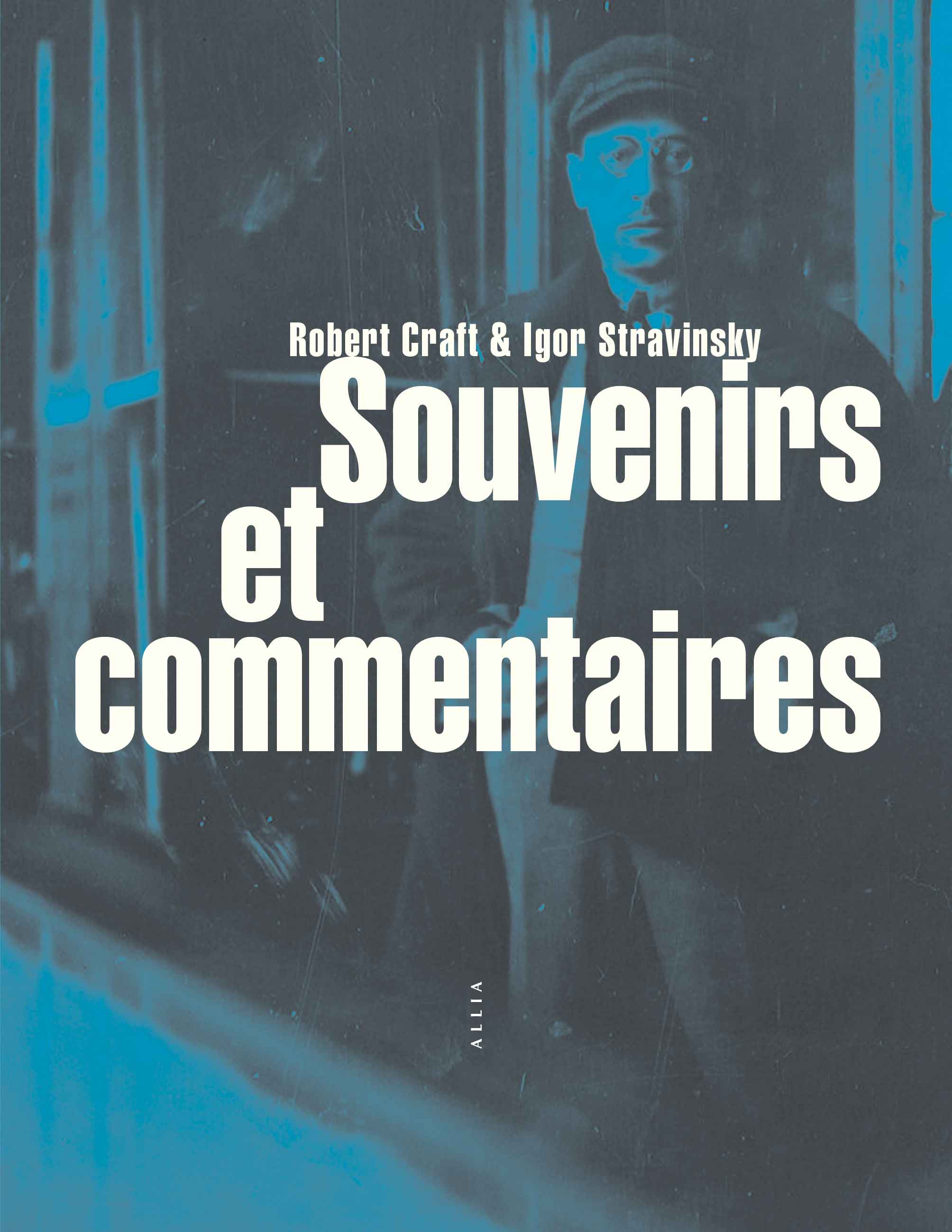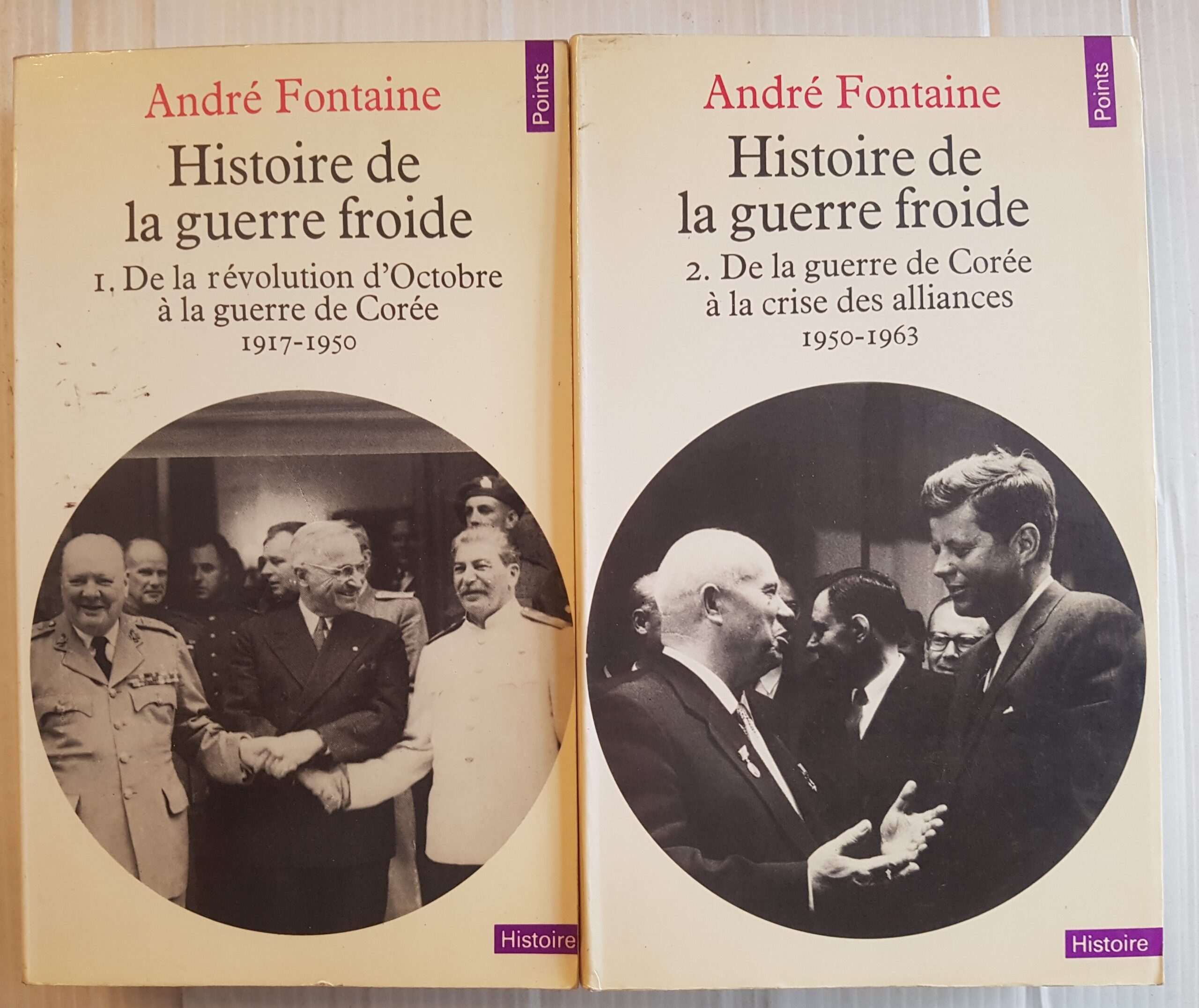![]()
Ce qui restera sans doute des années Jospin, c'est l'un des chefs-d'œuvres, à pleurer, de la chanson française : "La nuit je mens" d'Alain Bashung, une merveille d'artiste blessé et alcoolique avec qui il m'est arrivé de dîner, mais sans jamais parvenir à le suivre. Il était comme ses textes. Toujours dans un état second, il partait trop loin et ne revenait jamais. En l'espèce, il nous raconte l'histoire d'un type qui fait la cour à des murènes, prend des trains à travers la plaine et a dans les bottes des montagnes de questions.
Pendant des mois, j'ai écouté "La nuit je mens" en boucle, comme Dominique de Villepin, le secrétaire général de l'Elysée, qui la met souvent à tue-tête dans son bureau. La chanson nous rend tristes, comme l'époque. Tous deux inquiets pour le pays, nous nous voyons souvent.
Toqué de lui, je suis fasciné par son intelligence qui tournevire, galope et pile avant de pétarader, parfois, vers d'autres galaxies. À la manière de Chirac, il est un spectacle à lui tout seul, sauf que ça tourne parfois au film comique. Il a du souffle, Villepin, et ne manque pas d'air. Un coup, il est Chateaubriand. L'instant d'après, Vidocq. Puis l'inspecteur Clouseau dans "La Panthère rose", interprété par Peter Sellers. Une autre fois, le colonel de Gaulle en 1935. C'est un maréchal d'empire sans armée qui se prend pour Napoléon et soliloque dans le vide. Il est fou, comme moi, et entre fous on se comprend. Mieux, on s'apprécie. En tout cas, en ce temps-là.
Notre amitié s'est envolée quand il s'est amouraché du Qatar ou du Venezuela de Chavez, deux paradis sur terre de toutes les corruptions, et que j'ai compris qu'il voulait, en plus de s'étoffer, devenir président de la République, ce qui ne me semblait pas une bonne idée, du moins pour la France. Je me suis esbigné. Quelques années plus tard, un communiqué, passé inaperçu, de la maison Pierre Bergé et Associés m'apprit que Villepin avait vendu sa collection de livres anciens aux enchères, à l'hôtel Drouot, pour un montant total et miraculeux de 2,9 millions d'euros. En voilà au moins un qui avait bien profité...
Franz-Olivier Giesbert, Tragédie française, page 334