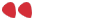Redstein a écrit :
Voir Hervé Kempf, "Comment les riches détruisent la planète"
Que se passe-t-il dans une société très inégalitaire ? Elle génère un gaspillage énorme, parce que
la dilapidation matérielle de l’oligarchie – elle-même en proie à la compétition ostentatoire – sert d’exemple à toute la société. Chacun à son niveau, dans la limite de ses revenus, cherche à acquérir les biens et les signes les plus valorisés. Médias, publicité, films, feuilletons, magazines « people » sont les outils de diffusion du modèle culturel dominant.
Comment alors l’oligarchie bloque-t-elle les évolutions nécessaires pour prévenir l’aggravation de la crise écologique ? Directement, bien sûr, par les puissants leviers – politiques, économiques et médiatiques – dont elle dispose et dont elle use afin de maintenir ses privilèges. Mais aussi indirectement, et c’est d’une importance équivalente, par ce modèle culturel de consommation qui imprègne toute la société et en définit la normalité.
jaime semprun a critiqué dans le chapitre 20 de
catastrophisme, administration du désastre et soumission durable les propos inoffensifs d'hervé kempf :
S'étant enhardi jusqu'à noter que les « les diagnostics exacts de Lester Brown, Nicolas Hulot, Jean-Marie Pelt, Hubert Reeves, on en passe, qui se concluent invariablement par un appel à l' "humanité" ne sont que de l'eau tiède sentimentale », le journaliste Hervé Kempf invitait récemment à « comprendre que crise écologique et crise sociale sont les deux facettes d'un même désastre » (
Comment les riches détruisent la planète, 2007). Il proposerait donc, en quelque sorte, de développer une critique
sociale des nuisances. Passons sans trop insister sur le caractère pour le moins éventé de ce scoop théorico-journalistique. Aussi tardive soit-elle, l'intention pourrait être louable, et méritoire, pour quelqu'un d'aussi néophyte en ce domaine. On est donc curieux de découvrir ce que peut bien signifier, pour le « journaliste d'environnement » du journal
Le Monde, cette « analyse politique radicale des rapports actuels de domination » qu'il conviendrait d'articuler à la « préoccupation écologique », et sans trop attendre : « D'ici dix ans, il faut avoir changé de cap. »
Car malgré tout, Kempf se veut « optimiste » : des « solutions émergent », « depuis Seattle et la contestation de l'Organisation mondiale du commerce » ; « le mouvement social s'est réveillé » et l'oligarchie
pourrait se diviser (une fraction prenant « nettement parti pour les libertés publiques et pour le bien commun ») ; « la corporation des journalistes
pourrait se réveiller » ; et la gauche « flageolante »
pourrait renaître « en unissant les causes de l'inégalité et de l'écologie ». Comme on voit, la critique sociale et l'analyse des rapports de domination ne risquent pas de le mener plus avant dans la radicalité qu'à la dénonciation des méfaits de l'oligarchie prédatrice et cupide des « hyper-riches ».
Quoique tout cela ne soit guère plus consistant ou éclairant que ne le serait un
best of des vingt dernières années de parution du
Monde diplomatique, Kempf est intéressant, et même instructif, par ce dont il ne parle pas. Car sa tentative critique omet
exemplairement d'analyser ou de seulement mentionner la composante la plus massive et certainement la plus apparente des « rapports actuels de domination », celle qu'un vingtième siècle écrasé par les « totalitarismes de transition », selon la formule de Mumford, a léguée au suivant : la bureaucratie. Par là, ce sont, comme toujours dans les inoffensifs ersatz critiques qui veulent bien mettre en cause le développement économique sans jamais s'en prendre à l'État, les meilleurs apports d'un siècle de critique sociale qui sont innocemment et très
convenablement passés à la trappe.
(page 54)