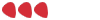Bon, comme j'ai retrouvé l'extrait en question et que je trouve ça très intéressant, je le retape pour vous en prime.
Glenn Gould: "Je n'ai jamais beaucoup travaillé mon piano, et aujourd'hui je ne le travaille quasiment plus, mais déjà, à cette époque, j'étais loin d'être esclave de mon instrument. Je préférais apprendre la partition à la lecture, simplement par la mémoire, et n'aller au piano que dans un deuxième temps (c'était là, bien sûr, une autre étape dans le divorce entre le tactile et les intentions expressives d'une sorte ou d'une autre). Enfin, ce n'est pas tout à fait exact, bien entendu, parce que l'interprétation se bâtit pour une part dès l'analyse, mais la dimension tactile, elle, en était exclue.
L'Opus 109 n'est pas une sonate particulièrement difficile, ni tendue, mais elle contient un passage qui est positivement horrible, comme vous le savez peut-être: il s'agit dans la cinquième variation du dernier mouvement, d'un trait diabolique, un saut de sixtes ascendantes. C'est un endroit ingrat, non seulement dans les doigtés, pour les passages entre les touches blanches et les noires, mais aussi dans sa position générale sur le clavier, à deux octaves à peu près du do du milieu, là où se posent le plus souvent les problèmes de répétition: à cet endroit il faut passer du doigté de sixtes au doigté de tierces, et cela en une fraction de seconde. Arrivés à cet endroit, les pianistes que j'ai vus jouer cette sonate ont toujours l'air de chevaux échappés d'une écurie en feu; tout dans leur visage exprime l'horreur, et je m'étais toujours demandé ce qui pouvait bien en être la cause.
Bref, deux ou trois semaines avant de jouer cette sonate pour la première fois, je commençai à étudier la partition, et à une semaine du concert je me mis au piano (cela semble suicidaire, mais c'est pourtant ainsi que j'ai toujours procédé). Et la première chose que je fis alors - c'était une folie, une grossière erreur psychologique - fut de me dire: allons, esseyons cette variation, histoire d'être sûr qu'il n'y a aucun problème; cela ne m'avait jamais semblé en être un lorsque, encore enfant, je m'asseyais et lisais la partition..., mais essayons, cela vaut mieux, juste un coup, pour mettre au point un petit doigté de rien, au cas où, n'est-ce pas. Je me mis donc à travailler mes doigtés, et tout alla de travers. Il me suffit de quelques minutes pour voir que j'étais complètement bloqué sur cette affaire. Et trois jours avant le concert j'avais tout essayé pour lever ce blocage: ne pas jouer la pièce, par exemple. Mais le blocage avait gagné du champ, et je ne pouvais pas arriver au passage en question sans piler net, littéralement, devant l'obstacle.
Je me glaçais. Je me suis dit alors qu'il fallait faire quelque chose, je ne sais pas, changer de programme, laisser tomber la variation en prétendant avoir découvert dans le manuscrit des choses que personne d'autre ne savait...Ces solutions ayant été rejetées, je décidai d'avoir recours au Ressort Ultime. Cette méthode consistait à placer, de chaque côté du piano, une radio ou, mieux encore, une radio d'un côté et une télévision de l'autre, et à mettre toute la sauce - c'est ici exactement la même expérience que celle dont j'allais lire, quelques années plus tard, le compte rendu: l'expérience de Chirurgie Dentaire Sans Anesthésie. Il fallait que le niveau soit suffisamment élevé pour que, tout en sentant ce que je faisais, je perçoive en premier le son de la radio, ou celui de la télé, ou, mieux encore, les deux ensemble. J'étais en train de séparer, à ce moment-là, ma concentration en deux parties, et je compris alors que cela, en soi, ne brisait pas la chaîne des réactions (d'ailleurs, cela avait déjà commencé à fonctionner: le blocage semblait vouloir se lever. Le fait de ne pouvoir s'entendre, de ne pouvoir constater ses propres faiblesses, marquait déjà un pas dans la bonne direction)."
Tiré de DRILLON, Jacques, ENTRETIENS AVEC JONATHAN COLT, Édition Agora, 1977, 167 pages.
God hates us all!