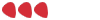Citation:
« On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine ; c’est l’ensemble de la civilisation qui élabore ce produit intermédiaire entre le mâle et le castrat qu’on qualifie de féminin ». (Beauvoir, 1976, 13)
2 On entend par naturalisation l’effet des instances sociales productrices des opérations catégoriel (...)
3 Colette Guillaumin a montré dans L’Idéologie raciste que le concept de race dans son acception (...)
4 Le psychologue américain John Money utilise le premier le terme genre en 1955 pour différencier le (...)
2Cette formule opère une rupture avec les textes médicolégaux et psychiatriques du XIXe siècle, qui ont établi l’adéquation entre sexe biologique et construction des catégories hommes et femmes. Autrement dit, Simone de Beauvoir, après la parution de Mœurs et sexualité en Océanie de Margaret Mead en 1935, met en doute les classifications naturalistes du siècle précédent, qui laissaient supposer qu’à mâle et femelle correspondaient, à travers des rôles et des pratiques spécifiques, le masculin et le féminin, définis par une surdétermination biologique. Ces travaux ont inauguré un changement dans les sciences humaines, en remettant en cause le déterminisme biologique fondé sur une opposition nature/culture, inné/acquis, et ont ouvert la voie à ce que l’on appelle aujourd’hui le constructivisme dans les études sur les rapports sociaux de sexe. Ces analyses ont été également à l’origine des critiques soulevées par les mouvements et les théorisations féministes contemporains, qui ont décrit et analysé les diverses formes d’exploitation que subissent les femmes, tant dans la construction collective et individuelle des corps que dans l’organisation sociale de l’espace domestique et public. Les études françaises issues du féminisme matérialiste s’attacheront, dès les années 1970, à la critique de la naturalisation2 des rôles féminins et masculins (Guillaumin, 1978 ; Mathieu, 1989, 2000). Ces analyses ont révélé que le rapport social se construit autour du marqueur de sexe et opère ainsi un classement entre les individus qui, en les hiérarchisant, justifie le rapport de domination des hommes sur les femmes. Tout comme le marqueur couleur de peau justifie une autre division sociale des individus3. Ces évolutions théoriques ont permis de montrer que ce n’est pas le sexe biologique qui fait d’un individu un homme ou une femme mais son genre4 social, c’est-à-dire une construction arbitraire et sociale des représentations des rôles propres aux hommes et aux femmes, résultats de rapports de pouvoir (Scott, 198
.
5 L’anthropologue Nicole-Claude Mathieu distingue les notions de sexe, de sexe social et de genre. E (...)
3Toutefois dans le domaine des recherches sur les rapports sociaux entre les sexes, certains auteurs s’interrogent sur l’utilisation de la notion de genre parce que, d’une part, son usage reléguerait le sexe à un registre biologique invariant et réduit à l’anatomie. D’autre part, le maniement de la notion de genre aurait tendance à neutraliser, en la masquant, la relation de domination régissant les rapports entre les sexes (Devreux 2004 ; Hurtig, Kail, Rouch, 2002 ; Mathieu, 19895 ; Tahon, 2004). Devenu un outil d’analyse au cours des vingt dernières années, le genre indique désormais « un rejet du déterminisme biologique implicite dans l’usage de termes comme “sexe” ou “différence sexuelle”. Le “genre” souligne également l’aspect relationnel des définitions normatives de la féminité » (Scott, 1988, 126).