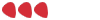jjloco a écrit :
de Ministry je connais que just one fix mais mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup influencé Rammstein au niveau son de guitare (et type de riff aussi), me trompe-je?
non
MaRc666 a écrit :
jaimerais connaitre ce qu'est le métal industrielle et quoi comme groupe de métal connu du métal industrielle
merci
jean-marc mandosio dans son texte, "je veux être une machine : genèse de la musique industrielle", donne trois dimensions au terme de "musique industrielle", chaque dimension n'étant bien sûr pas exclusive l'une de l'autre :
- musique produite industriellement : une musique est produite de façon industrielle, c'est-à-dire en série et selon des procédures standardisées, lorsque les différentes étapes du processus de réalisation d'une oeuvre musicale (écriture, édition, interprétation, enregistrement, promotion) sont rationalisées et intégrées pour former une chaîne de production.
on considère généralement que l'industrialisation de la chanson de variétés américaine a débuté au milieu des années 1880, quand les éditeurs de muisque commencèrent à se regrouper dans un même quartier de new york, à broadway, tout près de la zone où se trouvaient les salles de spectacle. dans ces quelques rues familièrement appelées "tin pan alley" ("la ruelle des casseroles de fer-blanc", à cause, dit-on, du tintement des nombreux pianos qu'on y entendait), toutes les catégories de la production musicale de l'époque étaient réunies : compositeurs, paroliers, éditeurs, imprimeurs, représentant de commerce, ces derniers étant des musiciens appointés pour aller jouer les nouvelles chansons aux entrepreneurs de spectacles.
des compositeurs tels qu'irving berlin ou george et ira gershwin faisaient partie de ce système. au début des années trente (et non soixante comme l'affirme le "dictionnaire du rock"), le brill building devint le centre et le symbole de ce quartier de la musique qui alimenta en tubes l'amérique jusqu'au début des années soixante-dix.
un tel système se limitait à l'édition de chansons qu'il revenait ensuite à des interprètes extérieurs d'enregistrer. en revanche, la célèbre firme muzak, fondée au milieu des années trente, fournissait, et fournit toujours, un produit musical totalement intégré, de la conception à l'enregistrement. son mode de production est entièrement rationalisé, et les gens qui la réalisent sont, d'un bout à l'autre de la chaîne, des exécutants anonymes. de la musique sans titre et sans auteur, exclusivement identifiée par le nom de la firme qui la commercialise ; autrement dit, de la musique industrielle à l'état pur.
les stations de radio, les studios de cinéma et les compagnies discographiques d'antan salariaient des compositeurs et des orchestres "maison" ayant pour tâche de composer et d'exécuter, du matin au soir, toute la musique d'accompagnement qui leur était demandée. quel que fût le genre musical, il n'était pas rare, jusqu'aux années soixante-dix, que les chanteurs ou les solistes enregistrent avec de tels orchestres, dont l'identité était totalement ignorée du public. ainsi, par exemple, ce sont les mêmes musiciens, employés par la petite maison de disques des frères leonard et phil chess, sise à chicago, qui ont accompagné dans les années cinquante aussi bien le bluesman muddy waters que le rocker chuck berry ; les publics respectifs de ces deux artistes n'imaginaient sans doute pas que l'auteur de "hoochie coochie man" et de nombreux autres blues, willie dixon, était le type qui jouait de la basse dans "johnny b. goode".
une autre maison de disques gérées par des noirs, la firme tamla-motown, de detroit, bâtit dans les années soixante son succès sur le fait qu'elle avait un "son" caractéristique, élaboré de façon très consciente pour plaire aussi bien au public blanc qu'au public noir et sortir du ghetto de la "race music". la cohérence stylistique et commerciale était garantie par le fait que toutes les musiques produites au sein de cette firme étaient composées, arrangées et interprétées par une équipe restreinte de musiciens de talent cyniquement exploités, fournissant aux chanteurs et aux ensembles vocaux des enregistrements déjà prêts, sur lesquels ils n'avaient plus qu'à poser leurs voix.
certains groupes de variétés n'ont pas joué une seule note dans les enregistrements commercialisés sous leur nom, de même que certaines starlettes au physique avantageux n'ont jamais chanté sur leurs propres disques, les producteurs ayant jugé plus prudent de confier cette tâche à des chanteuses professionnelles.
la mise sur le marché de groups factices pour adolescents est quant à elle toujours en vigueur.
- musique industrielle par destination : on peut appeler ainsi toute la musique spécifiquement conçue pour être diffusée dans des lieux publics, des discothèques, des radios ou des télévisions émettant de la musique en continu et nécessitant par conséquent d'être constamment alimentés en productions nouvelles, l'usure rapide des styles ne leur permettant pas de fonctionner en faisant simplement "tourner" un fonds toujours identique.
le fournisseur le plus connu de ce type de musique est la firme muzak. peu après sa création en 1934, muzak se spécialisa dans une "niche" commerciale qui n'avait jamais été exploitée jusqu'alors : la musique pour entreprises. cette firme proposa, d'abord à new york puis dans le reste des états-unis, deux types de produits : d'une part, des musiques d'attente pour faire patienter les clients au téléphone ; d'autre part, des musiques d'ambiance destinées à être diffusées à bas volume non seulement dans des lieux commerciaux recevant du public (hôtels, restaurants, boutiques...), mais aussi, à partir de 1937, dans des usines. cette année-là, en effet, une équipe de psychologues industriels britanniques démontra que la musique augmentait l'efficience des ouvriers.
[...]
pourtant, la musique d'ambiance n'avait pas été inventée par des psychologuesmais par érik satie au début du xxème siècle, sous le nom de "musique d'ameublement". l'idée de satie trouva une concrétisation avec la musique produite par muzak. celle-ci fut couramment appelée "musique d'ascenseur", car c'était dans ce lieu confiné que l'on prenait conscience de sa présence, autrement diluée dans l'espace ambiant. le nom même de la firme était devenu dépréciatif dans les années soixante, terme employé pour désigner toute musique mièvre et inconsistante. ainsi, après la séparation des beatles, lennon reprocha à son ancien collègue mccartney de faire de la muzak et non de la musique.
la musique d'ambiance, très discréditée, fut remise en vogue au milieu des années soixante-dix, sous une forme épurée, par le "non-musicien" avant-gardiste pop brian eno, qui lança en 1975 le concept de "musique discrète", puis en 1978 celui d'ambient music.
pour résumer : la musique du capitalisme industriel ou post-industriel, comme on voudra, présente un trait qui la caractérise, par-delà toutes les différences de styles : son omniprésence. qu'elle soit discrète ou agressive, planante ou rythmée, ancienne ou moderne, savante ou populaire, la musique constitue la "bande-son" de la vie quotidienne des sociétés contemporaines, à laquelle il est pratiquement impossible d'échapper. certains "espaces piétonniers" des centre-villes comportent des haut-parleurs placés à intervalles réguliers, faisant de la rue un centre commercial à ciel ouvert. cette "immense accumulation de marchandises" qu'est la société du spectacle implique un accompagnement musical continu, transformant l'existence tout entière en une suite ininterrompue de spots publicitaires.
c'est bien à ne pas entendre le bruit de fond de notre civilisation que sert toute cette musique constamment diffusée pour ne pas être écoutée. un bruit si insoutenable dans sa brutalité que nous préférons le dissimuler sous un flot permanent de musique, beaucoup plus rassurant malgré la souffrance de nos oreilles et la confusion mentale qui en résulte.
- thèmes industriels dans la musique : à l'inverse de la tendance qui vient d'être décrite, il existe aussi des musiques que l'on peut dire industrielles dans la mesure où elles se présentent comme un reflet, réaliste ou stylisé, des sociétés contemporaines.
dès le début du xxème siècle, l'idée d'utiliser les bruits industriels comme matériau musical germa au sein des avant-gardes artistiques, avant même qu'il ne fût techniquement possible de la réaliser. dans son manifeste de 1913, "l'art des bruits", le futuriste italien luigi russolo écrivait : "traversons ensemble une grande capitale moderne, les oreilles plus attentives que les yeux, et nous varierons les plaisirs de notre sensibilité en distinguant les glouglous d'eau, d'air et de gaz dans les tuyaux métalliques, les borborygmes et les râles des moteurs qui respirent avec une animalité indiscutable, la palpitation des soupapes, le va-et-vient des pistons, les cris stridents des scies mécaniques, les bonds sonores des tramways sur les rails. nous nous amuserons à orchestrer idéalement les portes à coulisses des magasins, le brouhaha des foules, les tintammarres différents des gares, des forges, des imprimeries, des usines et des chemins de fer souterrains."
d'autres futuristes tentèrent de réaliser ce programme après la révolution russe : "une symphonie spectaculaire de "musique prolétarienne" fut interprétée le 7 novembre 1922 avec des sirènes d'usine, des sifflets à vapeur, des pièces d'artillerie, des mitraillettes et des avions, le tout dirigé depuis les toits de bakou."
de telles initiatives restèrent toutefois extrêmement rares, pour d'évidentes raisons de logistique. russolo avait par ailleurs inventé toute une série de machines à bruits qui ne furent presque jamais utilisées. l'unique enregistrement de ces instruments réalisé en 1924 est gâché par la composition insignifiante du frère de russolo.
des compositeurs beaucoup plus talentueux réussirent en revanche à faire entrer, en recourant à des instruments conventionnels, les sonorités industrielles dans la musique, créant du même coup une esthétique nouvelle, fondée sur la discordance et le chaos plutôt que sur l'ordre et l'harmonie. ainsi, la "pantomime" de béla bartók "le mandarin merveilleux" (1919), dont l'action se situait dans les bas-fonds d'une ville moderne, débutait par une cacophonie provocatrice faite de percussions et de bruits de klaxons.
de même, le "mouvement symphonique" pacific 231 d'arthur honegger (1923) se voulait une évocation musicale de la locomotive à vapeur du même nom. elle inspira la symphonie nº 2 de serge prokofiev (1924), dite "symphonie de fer et d'acier", présentée comme une expérience de "machinisme musical".
un exemple beaucoup plus récent d'imitation musicale de bruits industriels, mais avec cette fois une instrumentation électronique, est la longue suite "trans-europe express" de kraftwerk (1977), dont le célèbre rythme est une transposition de la cadence hypnotique produite par les roues des wagons heurtant les jointures des rails, que l'on entend de l'intérieur d'un compartiment quand on voyage en train.
le morceau contient aussi une évocation de l'effet doppler, cette sensation de montée et de descente du son éprouvée lors du passage d'un train ou de tout autre véhicule rapide. la section instrumentale de sept minutes est intitulée "metal on metal" et évoque précisément le frottement et le cliquetis d'un mécanisme métallique, tandis que le train poursuit, inflexible, sa route. trans-europe express s'achève sur la reproduction très réaliste du freinage et de l'arrêt du train.
l'un des principaux jalons de l'esthétique "industrielle" dans le domaine musical fut sans aucun doute le ballet "le sacre du printemps" d'igor stravinski, créé à paris en 1913 avec le scandale que l'on sait. c'est là qu'apparut pour la première fois ce caractéristique mélange d'inspiration primitiviste et de style ultra-moderne, obtenu en empruntant des éléments formels aux cultures que l'on appelait alors "primitives" : en l'occurence, une musique à base de percussions "tribales", inspirées de ce même "tam-tam des sauvages" qu'adorno reprochera au jazz de prendre pour modèle.
en peinture, le même phénomène avait eu lieu quelques années plus tôt, quand picasso s'était servi, de façon également jugée scandaleuse en son temps, de masques "nègres" dans son tableau "les demoiselles d'avignon" (1907).
la rythmique spectaculaire élaborée par stravinski - utilisation percussive de l'orchestre, martèlement rehaussé de temps forts irréguliers - fut ensuite adaptée par d'autres compositeurs pour évoquer la guerre mécanisée ; ce modèle rythmique exprimait on ne peut mieux la "sauvagerie primitive" de la guerre, démultipliée par l'équipement technique de la société industrielle.
en 1918 fut créée à londres la suite symphonique de gustav holst, "les planètes", évocation musicale des douze signes du zodiaque, qui s'o que uvrait sur une pièce effrayante écrite en 1914, juste avant le début de la grande guerre : "mars, le porteur de guerre", entièrement construite autour d'un rythme implacable maintenu pendant toute la durée du morceau, dans un crescendo cataclysmique. en 1942, dans sa symphonie nº 7, dmitri chostakovitch utilisa un leitmotiv percussif s'intensifiant progressivement, comme celui de holst, pour représenter l'armée allemande dévastant tout sur son passage.
le même type de construction rythmique réapparut, chez certains groupes utilisant des instruments électriques avec de plus vastes ambitions musicales que le rocker moyen, pour évoquer l'aliénation moderne. le groupe français magma s'illustra notamment par une suite dont le titre se passe de commentaires - "mekanik destruktiw kommandoh" (1973) - et dont le rythme obstiné descend en droite ligne de stravinski et de carl orff. dès 1969, le groupe anglais king crimson, dirigé par le guitariste robert fripp, s'était signalé par un morceau remarquablement intense et oppressant ("21st century schizoid man"), avec des parties chantées, ou plus exactement déclamées par une voix distordue au mégaphone, qui décrivait la schizophrénie de l'homme du 21ème siècle, entre consumérisme compulsif et pluies de napalm.
le sentiment de panique était suscité par des variations mélodiques et rythmiques très rapides tout au long du morceau, construit comme une tentative de maîtrise névrotique d'un chaos finalement voué à échapper à tout contrôle. en 1970, king crimson enregistra une longue version de "mars, le porteur de guerre", sous le titre "the devil's triangle". d'autres de ses compositions instrumentales - "lark's tongues in aspic, part 2" (1972), "fracture" (1973), "red" (1974) - reprenaient les principes rythmiques établis par stravinski et bartók pour produire une impression d'enfermement dans un univers dystopique et glacial, toujours sous la menace d'un effondrement imminent.
le morceau intitulé "industry" (1984), en revanche, s'apparentait davantage à une sorte de free-jazz électrique - toujours dans le genre oppressant -, mais entre-temps king crimson avait fait des émules : en france, le groupe heldon enregistra en 1976 "un rêve sans conséquence spéciale", album composé de quatre longs morceaux où les instruments électriques et électroniques s'associaient pour construire un univers de cauchemar industriel (la pochette du disque représentait une usine sidérurgique). et en angleterre, la même année, le groupe this heat poussait à l'extrême les recherches inaugurées par king crimson avec une impressionnante composition intitulée "testcard", où une masse sonore d'une densité presque insoutenable, avec de fortes variations de vitesse et d'amplitude, était brutalement hachée par des blocs de silence.
ce n'est pas toutefois ce genre de musique, reposant sur l'utilisation raisonnée d'une technique compositionnelle et instrumentale non négligeable, qu'on a pris l'habitude d'appeler depuis la fin des années soixante-dix, "musique industrielle". ce terme, dans son acception actuelle, fut appliqué pour la première fois au groupe anglais throbbing gristle, formé en 1975, qui trouva un public grâce à la remise à plat des critères esthétiques provoquée par le mouvement punk (1976-1977), dans le sillage duquel proliférèrent toutes sortes de "conglomérats approximatifs", souvent éphémères, "opérant à la frontière de la musique et du bruit". ils avaient été précédés sur cette voie par certains représentants du krautrock allemand, et le climat particulièrement sinistre qui régnait en grande-bretagne à l'époque.
Throbbing Gristle - dont le nom pourrait se traduire par "sexe turgescent" - était au départ un collectif d'artistes originaires de la ville industrielle de Hull, influencés par le mouvement Fluxus et les actionnistes viennois, qui se lança dans l'expérimentation sonore en adoptant une approche résolument anti-musicale. Leur volonté de choquer les rapprochait des punks, mais ils considéraient ceux-ci comme beaucoup trop inféodés à la musique et en particulier au rock, comme l'expliqua la tête pensante du groupe, Genesis P-Orridge : "En fait, je me sens toujours incroyablement offensé quand je vois quelqu'un faire référence à moi comme à un musicien. Avec Throbbing Gristle, ma première exigence fut de demander à chaque personne impliquée qu'il n'y ait ni batteur, ni guitariste solo, ni guitariste rythmique. J'ai souvent débattu de la question avec des groupes punks, qui disaient : "Apprenons trois accords et formons un groupe." Et je pensais : "Mais pourquoi diable apprendre trois accords !" Pour moi, c'est là que repose le problème du punk : les punks voulaient apprendre à jouer de la musique."
la décision de produire, non pas de la musique, mais le véritable reflet sonore d'un monde brutal et déshumanisant, résultait d'une réflexion semi-délirante sur la notion d'esclavage : "je pensais à tort ou à raison, que toute la musique populaire occidentale descendait de la musique féodale, de la musique des esclaves, et je n'étais pas pressé de m'avouer ancien esclave dégénéré. je suis un enfant de la classe moyenne blanche. apprendre à jouer de la musique enracinée dans le rhythm & blues, c'est une nouvelle fois devenir l'esclave du système. alors si tu dois jouer de la musique d'esclave, autant que ce soit celle d'un esclave de la société post-industrielle, d'une société où les gens travaillent dans les usines. et ça personne ne l'avait jamais vraiment fait. personne n'avait pris la décision effective de jouer une musique enracinée dans l'expérience de la société occidentale européenne et de la société industrielle, et c'est donc ce que nous avons fait. nous nous sommes inspirés des tapis roulants, des usines, des centrales électriques et des biens de consommation de masse pour imaginer les formes de notre musique, et nous avons expérimenté à partir de ces matériaux, plutôt qu'à partir de guitares."
l'univers reflété par throbbing gristle se voulait celui de "la classe moyenne blanche" et ne se reconnaissait aucune affinité avec le rock, censé être issu de la "musique des esclaves" américains.
les enfants de la classe ouvrière britannique se passionnaient au contraire pour le heavy metal. ce "métal lourd" dérivé du blues-rock anglo-américain des années soixante, dont l'imagerie grand-guignolesque et le satanisme de pacotille provenaient du cinéma d'épouvante et comics, était aux antipodes de l'extrémisme anti-artistique de la "musique industrielle", puisqu'il privilégiait la virtuosité instrumentale, notamment en matière de guitares. sa mise en scène outrée de la "volonté de puissance" constituait l'exutoire idéal des frustrations d'une jeunesse défavorisée qui n'avait d'autre avenir que le travail à la chaîne ou le chômage. les membres de l'un des groupes phares du heavy metal, black sabbath, étaient d'extraction ouvrière ; leur guitariste, tony iommi, avait eu un doigt sectionné par une machine à l'époque où il travaillait à l'usine.
se définissant comme un "laboratoire de recherche chaotique" dont les disques constituaient les "rapports annuels", throbbing gristle produisait, lors de ses concerts qui duraient toujours exactement une heure (au terme de laquelle le courant électrique était coupé, quoi qu'il arrive), un vacarme indescriptible à base de sons et de voix manipulés et déformés de mille façons. ce n'était pas à proprement parler une "musique de machines" car les instruments restaient joués manuellement et aucune machine n'aurait pu sortir ces sons avec une telle agressivité et une telle énergie percussive.
le leader du groupe explique ainsi les concerts de throbbing gristle : "pendant les cinq dernières minutes des concerts, c'était le moment de ce qu'on appelait le "tourbillon sonore" : on réglait tout au maximum, minimum de fréquences medium, mais maximum de graves et d'aigües. et puis on tapait sur tout ce qui pouvait produire du bruit, et on passait ce bruit par tous les processeurs possibles jusqu'à ce que cela dépasse le bruit blanc ou "metal machine music", que cela devienne quelque chose d'impossible à appréhender pour le cerveau. c'était tellement écrasant que ça devenait presque du silence."
Le but de l'opération, parfaitement atteint, était de susciter le malaise chez les auditeurs. Throbbing Gristle cultivait la provocation et se réjouissait d'avoir été qualifié par un quotidien anglais de "destructeurs de la civilisation". Toutefois, certains de ses enregistrements en studio ressemblaient beaucoup plus à la techno-pop de Kraftwerk qu'à du bruit blanc, et le slogan publicitaire de la firme Industrial Records, fondée par le groupe ("Musique industrielle pour gens industriels") ainsi que certaines de ses pochettes de disques trompeusement anodines, visaient à semer le trouble dans l'esprit des acheteurs en faisant passer Throbbing Gristle pour un groupe de musique pop.
Si les séances de torture auditive orchestrées par Throbbing Gristle ne suscitèrent jamais l'enthousiasme du grand public, il en alla autrement pour Kraftwerk, dont les mélodies simples passaient souvent à la radio. La musique de ce groupe allemand se voulait pourtant, elle aussi, le reflet de la société industrielle et tournait le dos à l'esprit de négation de la réalité industrielle qui avait caractérisés les hippies : "Nous Kraftwerk, nous sommes le groupe du réalisme urbain. [...] On ne peut pas nier notre relation à la technologie. Il faut être réaliste. Comment peut-on travailler dans un studio, avec des amplificateurs, des baffles, des magnétophones, et écrire une chanson qui parle de chevaux et de filles dans la prairie ? C'est une fuite. Nous voulons être réalistes et être de plus en plus conscients au milieu de cette réalité. Notre existence, c'est de vivre dans une ville dont on ne sort jamais, Düsseldorf. Kraftwerk est un produit des révolutions industrielles. Kraftwerk a une musique rigide parce que son environnement est rigide."
Ce réalisme affiché se voulait neutre, n'impliquant aucun jugement pour ou contre la : technologie ; il recouvrait néanmoins une adhésion profonde aux valeurs implicitement véhiculées par l'électronique : "Nous ne voulons plus de la musique artisanale comme le rock, qui est dure, où l'on transpire, où l'on se coupe les mains sur les cordes. Il y a des machines propres pour faire de la musique maintenant. Ceux qui les rejettent ne peuvent aboutir qu'à la destruction. J'ai vu les Who casser leurs amplis à la fin d'un concert. C'est infantile. D'ailleurs la musique électronique peut nous guérir de nos malaises : actuellement on utilise la musique électronique dans des centres de psychothérapie pour soigner les dépressions nerveuses. Nous pensons que la musique de Kraftwerk est une médecine psychologique pour ceux qui ne supportent pas assez bien la réalité."
Contrairement à des groupes "industriels" comme Throbbing Gristle ou Cabaret Voltaire, dont l'univers sonore était tendu et aliénant, Kraftwerk - après des débuts acoustiquement très rudes - pratiquait une musique beaucoup plus plaisante, propre à réconcilier l'homme et la machine. Ralf Hütter considérait que cette disposition à accepter sans états d'âme la modernité industrielle résultait à la fois de la mentalité allemande : "C'est en Allemagne que fut inventé le magnétophone. Je pense que Kraftwerk n'aurait jamais pu naître ailleurs. Nous sommes un groupe profondément allemand, non seulement parce que nous vivons ici, mais parce que nous sommes rattachés à une pensée scientifique, mathématique et technologique typiquement allemande. Il y a dans ce pays une fascination pour une création de type scientifique."
On voit ainsi pourquoi il a souvent été question de musiciens allemands dans les pages qui précèdent. Une telle explication a toutefois ses limites, puisque la "musique industrielle" s'est également développée en Angleterre et aux USA, où des groupes tels que Devo, Chrome ou Pere Ubu livrèrent leur propre version de la chose. Les propos des membres de Pere Ubu, groupe fondé en 1975 dans la ville industrielle de Cleveland, n'avaient rien à envier en matière de réalisme à ceux de Kraftwerk ou de Throbbing Gristle : "La vie est dure, elle est perturbante, ce serait absurde de le nier, et c'est bien pour ça que notre musique n'a rien de doux ou de lumineux."
Les solutions musicales adoptées par Pere Ubu étaient néanmoins très différentes de celles des deux groupes susnommés et relevaient davantage d'une sorte de post-rock expérimental. On trouvait en outre chez eux un mélange de répulsion et de fascination envers le monde contemporain, avec une sensibilité à la poésie industrielle dont les accents étaient proches de l'ancien futurisme.
Jacques Ellul a eu le mérite, peu répandu chez les penseurs critiques, d'essayer d'analyser l'émergence de la "musique industrielle" à la fin des années soixante-dix. Dans son livre de 1980 sur l'art et la société technicienne, il renvoyait dos à dos le punk et le disco, deux exemples équivalents à ses yeux de l'insignifiance glacée de l'hypnotisme technicien, malgré leur hostilité réciproque. La remarque n'était pas infondée, puisque le punk, avec des motivations et une esthétique radicalement différentes de celle du disco, aboutissait au même résultat : la simplification métronomique du rythme, hédoniste et dansant dans un cas, névrotique et crispé dans l'autre.
La brève explosion punk céda vite la place à une constellation "post-punk" plus expérimentale qui employa souvent des motifs percussifs et des lignes de basse inspirés du disco, pour servir de support rythmique à de stridentes rafales de guitares, synthétiseurs ou autres instruments. La visée fut d'abord parodique et grinçante, comme dans le morceau de Public Image Ltd. intitulé "Death Disco" (1979). Cette phase parodique se transforma au bout de quelques années en une réappropriation au premier degré de la musique de danse ; d'anciens représentants de la musique industrielle comme Cabaret Voltaire et Human League, ou de la cold wave comme New Order (ex-Joy Division), jetèrent alors les bases de ce qui allait devenir la techno.
Certains propos d'Ellul relatifs à d'autres formes d'art contemporain peuvent être appliqués à la musique industrielle : "En dévoilant les irrationalités de notre époque, l'anti-art produit ces mêmes irrationalités, provoque des comportements inadaptés. Il produit des modèles explicites et visibles des phantasmes collectifs de l'obsession de la mort, de l'absence de signification, de la destruction. Cet art joue un double rôle, contradictoire : il fait profession d'être une révolte contre notre culture hypermécanisée, hyperenregimentée, mais il justifie en même temps les produits du système de puissance. Il acclimate l'homme à vivre dans ces villes, dans ce milieu, il le convainc que ce monde d'absurdités, de violence, d'anonymat est le seul monde possible. Il lui fait recevoir que l'environnement dégradé par les décharges d'ordures, les piles nucléaires, les autoroutes, la pollution, la destruction du milieu naturel est ce qui est naturel et bien."
Expression consciente d'une désintégration individuelle et sociale bien plus souvent niée que revendiquée dans la musique dite populaire, la "musique industrielle" n'a précisément rien de populaire et ne touche qu'un public limité.
Musique hideuse pour un monde hideux ou, selon l'expression de Ralf Hütter, "médecine psychologique pour ceux qui ne supportent pas assez bien la réalité", la musique industrielle, sous ses différentes formes, est en parfaite adéquation avec la société qu'elle prétend refléter, et contribue à la rendre acceptable.