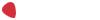Citation:
Non, pour la démocratie , par Vincent Tournier
LE MONDE | 04.05.05 | 13h41
Les partisans du traité constitutionnel européen ont certainement de très bons arguments à faire valoir. Ils peuvent à juste titre soutenir que les dispositions prévues par le traité ne modifient pas radicalement les textes antérieurs et que, par contre, elles permettent globalement de faire quelques avancées significatives du point de vue du fonctionnement des institutions.
Il leur est en outre assez facile de discréditer leurs opposants en soulignant que le non est soutenu par des personnalités ou par des partis peu fréquentables, à l'exception notable de Laurent Fabius, ce qui permet au passage de redistribuer à leur profit les temps de parole pour la campagne référendaire.
Pourquoi donc cette belle mécanique est-elle en passe de dérailler ? Le fait est que les institutions européennes ne parviennent pas à séduire.
La cause en est moins un problème de communication qu'un problème de fond. Quoi qu'on en dise, l'Europe repose sur un ensemble de dispositions qui ne respectent pas les prérequis d'un régime démocratique digne de ce nom. On peut certes justifier le "déficit démocratique" par les nécessaires compromis entre les Etats.
C'est ce que font généralement les franges aisées et cultivées de la population qui, mieux informées que la moyenne, soutiennent d'autant plus facilement la construction européenne qu'une certaine compétence technique leur procure ce délicieux sentiment de faire partie du monde des initiés.
De leur côté, les experts se sentent autorisés à dire que l'Europe invente un nouveau type de régime politique, une "nouvelle forme de gouvernance" .
Au diable, donc, les archaïsmes de la démocratie de papa ; soyons résolument modernes, comme le voulait le poète Jaromil dans le roman de Milan Kundera La vie est ailleurs. Et Dieu sait si, de nos jours, être moderne, c'est être pour l'Europe, tant il est facile de provoquer l'enthousiasme des foules, notamment chez les jeunes, en jouant habilement sur quelques idées à la mode comme le pacifisme, le rapprochement entre les peuples ou encore la fin des idéologies nationales.
Mais, dans un domaine aussi fondamental et fragile que la démocratie, l'innovation doit rester prudente. Si les principes démocratiques traditionnels manquent probablement d'attrait, ils n'en ont pas moins été éprouvés par des siècles d'affrontements et de débats. Si la complexité et l'originalité des institutions européennes suscitent logiquement la fascination des élites et des universitaires, encore faut-il souligner que cette attirance intellectuelle n'est pas un bon critère pour fixer les règles du jeu démocratique, lesquelles doivent surtout être comprises et acceptées par les citoyens ordinaires.
Les institutions européennes représentent une belle mécanique intellectuelle, mais elles échouent devant une question élémentaire : finalement, qui décide de quoi ? Un haut niveau de technicité constitutionnelle et juridique ne saurait en aucun cas remplacer la bonne vieille séparation des pouvoirs, c'est-à-dire un organe législatif élu par les citoyens et doté d'un pouvoir d'initiative et d'approbation dans les domaines législatif et budgétaire, un pouvoir judiciaire indépendant capable de faire respecter d'authentiques droits fondamentaux, une claire répartition des compétences, le tout reposant sur la responsabilité des dirigeants et la transparence des décisions.
On a pu dire que ceux qui ont soutenu le traité de Maastricht (1992) devraient nécessairement soutenir le traité constitutionnel. Cet argument est discutable. Le traité de Maastricht a été conçu comme une première étape vers la création d'une Europe politique. D'ailleurs, il était prévu de le réviser assez rapidement dans le cadre de nouvelles négociations intergouvernementales. Or loin d'avoir corrigé les défauts initiaux, les révisions successives d'Amsterdam (1997) et de Nice (2000) n'ont fait que diluer un peu plus les responsabilités et accentuer l'opacité.
Là aussi, il suffit de se livrer à un test simple : aujourd'hui, auprès de qui un citoyen mécontent de l'Europe peut-il aller se plaindre ? Le traité constitutionnel ne fait qu'aller dans le même sens que les précédentes révisions : il se contente de jouer à la marge, d'apporter tel correctif ici, de compléter tel dispositif là, sans oser s'attaquer au cœur du problème, c'est-à-dire les (dés)équilibres initiaux.
D'où vient cet immense gâchis ? Une première réponse se trouve certainement dans le projet fondateur lui-même, auquel les Français ont d'ailleurs fortement contribué, puisque celui-ci a été conçu comme un moyen de rationaliser le pouvoir au profit d'experts et de techniciens dans l'espoir d'affranchir la prise de décision des contingences de la vie politique.
Cette interprétation n'est toutefois pas suffisante car, avec le temps, les choses auraient pu évoluer autrement. Il faut donc avancer une autre hypothèse : le projet européen n'est pas (ou n'est plus, si l'on estime que cela a pu être le cas au début, ce qui n'est pas garanti) porté par l'histoire. Car la question que l'on doit se poser est bien la suivante : est-il possible de décider, quasiment du jour au lendemain, de faire une Constitution ? Une Constitution peut-elle se décréter dans les salons feutrés des conférences intergouvernementales ?
Pour ceux qui sont persuadés que la politique n'est jamais qu'une affaire de techniques juridiques et d'administration des choses, la réponse coule de source : c'est oui. Mais toute l'histoire constitutionnelle (à commencer par celle de la France, particulièrement riche en ce domaine) montre une réalité bien différente. Elle indique que les Constitutions sont toujours l'œuvre de circonstances exceptionnelles, elles naissent dans la douleur, parfois même dans le sang ; elles se conçoivent toujours comme la volonté de répondre à des problèmes et à des clivages majeurs qu'il s'agit de dépasser.
Aujourd'hui, quel est le drame qu'il faut surmonter ? Où est le vent de l'histoire qui pourrait inspirer une Constitution au peuple européen, si tant est que celui-ci existe ? Ce souffle de l'histoire, certains ont pensé le créer de toutes pièces, que ce soit en dramatisant les enjeux ou, mieux, en traçant un parallèle direct avec l'histoire, par exemple en dénommant "convention" les diverses commissions chargées de rédiger la Constitution et la Charte des droits fondamentaux, référence puérile à la convention de Philadelphie et aux Pères fondateurs de la démocratie américaine. C'est ignorer pourtant que l'histoire ne se répète pas. Ou alors sous forme de farce, comme le disait Marx, qui n'avait pourtant pas beaucoup d'humour.
Posons le problème plus crûment encore. Finalement, qui a rédigé la Constitution ? Passons sur le nombre dérisoire des intervenants (à peine plus d'une centaine, avec un tout petit noyau d'actifs) et sur leur absence de légitimité en raison du refus d'élire une véritable Assemblée constituante. Sans chercher à faire injure à ces quelques dizaines de personnes, qui étaient certainement pétries de bonnes intentions, et sans non plus faire l'apologie de l'homme providentiel, étaient-elles vraiment à la hauteur ?
Force est de constater que, dans les circonstances exceptionnelles, ce sont des personnalités exceptionnelles qui émergent, des gens hors du commun, dotés d'un sens aigu de la politique et de l'histoire. Par temps calme, seuls se relaient à la barre des personnalités de second ordre ou des techniciens de la politique, des petits joueurs en somme.
Ne cherchons pas plus loin : c'est bien dans cette routinisation tranquille et administrative de l'intégration européenne que se trouvent la déception et la frustration que ressent tout citoyen de bonne volonté à la lecture du traité constitutionnel, texte ô combien laborieux s'il en est. Faut-il dès lors prendre le risque de brusquer les choses ?
--------------------------------------------------------------------------------
Vincent Tournier est maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Grenoble.