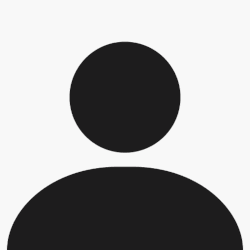lemg a écrit :
Alors comme ça il faut tirer sa révérence. A qui ? Peut-être aux vieux fans, en leur faisant d'emblée comprendre que ça ne va pas être simple pour eux. Muse embarque dans un vaisseau doté de la dernière technologie de l'année 1978, tente le coup techno, ça marche, c'est jouissif (le son pour le son) mais le vaisseau est rapidement secoué de spasmes qui ont un nom : guitare.
Take a bow, entrée en matière risquée mais indispensable au vu de ce qui va suivre.
Starlight, le vaisseau a explosé, des myriades de résidus obsolètes planent dans l'ether et le groupe de flotter au milieu, histoire de remémorer le clip de
Bliss. Certains vont s'y raccrocher ainsi qu'à la ligne de basse terriblement musienne, aux arpèges sous perfusion whammy-delay, croiront que le groupe chéri d'avant est encore possible.
Mais le groupe chéri a prévu le coup de grâce pour le troisième morceau.
Aspiré par un trou noir -
Supermassive black hole - et voilà que les naufragés (à ce stade on se demande qui l'est le plus, le fan ou le groupe) se retrouvent on ne sait comment sur la planète Boulhaphaasseth, une planète qui scintille, une planète affreux miroir de ce que pourrait devenir la nôtre si chacun faisait ce qu'il voulait : devenir chanteur. Une planète aux couleurs vives en alternance, aux êtres à la pigmentation aléatoire. Aléatoire aussi la sexualité, un castrat mène la danse, accompagne la naissance de choeurs très présents que tente de contrer une voix robotisée. Le solo est un flot d'informations digitales mal contrôlé qui se répand dans le public et que semble ignorer le castrat qui reprend encore et encore, flottant par dessus un orchestre a qui on a visiblement bien inculqué la notion de riff efficace. Un truc se dessine. Une carte. Et pour certains : une problématique.
"Dépêche Dom" semble crier Matiou à son batteur. Celui s'exécute à deux reprises, affolant les chevaux et les retenant au dernier moment. Les chevaux, on en reparle plus tard. Pour le moment, la rythmique saccade et dresse un corsage électrorock surpuissant, une armure pour le New born guerrier. Met en place une stratégie.
Map of the problematique.
La grosse production est confirmée, le guerrier nouveau est bien armé.
Le guerrier nouveau attend. Corvée de chiottes ou pas on l'ignore toujours est-il qu'il a sorti les balais. Bellamy plaque par dessus une ligne de guitare labyrinthique dont il ne s'extraiera pas seul. Alors il convoque les choeurs, beaucoup de choeurs, des choeurs partout et le nom est lâché : Queen.
A soldier's poem. Deux minutes d'ambiance en noir et blanc qui réveillent des fulgurances de Bogart à Casablanca. Derrière ce calme apparent il y a des avions chargés, lourds. Il va falloir la jouer serrée.
En rang serrés. Ensemble nous sommes invincibles. Porté par un son (à ce stade d'hybridation voix-guitare-n'importequoi-kaos pad on ne trouvera pas d'autre terme) qui se fond dans l'imprécation du chanteur plus qu'elle ne la souligne, le bien nommé
Invincible se balade et présente la panopie complète du guitariste petit format préféré de ses dames. Une chose est sûre Bellamy cherche et même, il ne trouve pas. Histoire que tout le monde le sache, il pompe sans vergogne
I still haven't found (what I'm looking for) de U2, non sans oublier de pousser ses guitares à la limite (comment ça to the edge ?).
Assassin. Riff concassé. Roulette de dentiste qui attaque le cortex. Cliquetis ancré à jamais avant que ne déboule son grand frère, la version
sur la corde la plus grave, parsémé de dissonances concertées qui s'entrechoquent telles les armures du guerrier. Qui donc s'est mué en assassin. Le monstre dont la colonne ne se compose pas de vertèbres comme vous tous (quel horrible manque d'originalité, vous devriez avoir honte) mais de la discographie complète de Queen. Cette fois c'est sûr. Emballé vendu. Bellamy fait une fixette. Bouche tous les trous au mastic Mercury-May-Deacon-Taylor. Par moment, ça déborde mais il n'en a cure, il n'a pas l'intention de s'arrêter là, comme vont le prouver les sons de guitares voxiens de la chanson suivante.
Fausse évidence du riff ? Le père Matthieu répond par un survol de scie musicale technoïde - ou bien Theremin est venu dire bonjour - kidnappée dans une série Z étouffée par de l'hémoglobine trop épaisse. Trop rouge. Trop abondante.
Fausse simplicité mélodique du refrain ? Le père Matthieu répond par une explosion de lenteur : "I'm waiting patiently". L'auditeur est en droit de s'étonner. Etant donnée la vitesse d'exécution du disque (et des fans retors) on l'aurait juré pressé d'en finir.
C'est
Exo-politics, mesdames messieurs. Si par hasard vous avez découvert ce disque par la plage 8, vous vous dites que Muse évolue en douceur. Rejoignez-nous à la plage 9.
City of desillusion. Espagnolades accoustiques. Motif techno. Cordes arabo-andalouses. Grosses guitares, on roule au Diezel. Trompettes. Choeurs (remember, Queen), voix haut perchée. Alternance. Tête qui tourne. Ce titre est une déclaration de ce que vous voulez. C'est un résumé aussi. Du disque ou de la carrière du groupe c'est selon. Enfin, génial ou ridicule, délice de fin gourmet ou indigestion garantie, le trio se meut sur un fil depuis ses débuts. Avec cet album, le fil est encore plus mince, de quel côté vont-ils tomber ? Beaucoup auront déjà fait leur choix depuis longtemps.
Epuisé mais ce n'est pas fini. Ca commence par une guitare guimbarde violentée à la reverb. C'est poussiéreux, mais l'autre par dessus il s'en fout il chante délicatement comme si son larynx n'avait rien à craindre de quoi que ce soit. Tellement rien à craindre qu'il va poser un piano mégalomane au milieu, s'ôter les tremolos de la voix pour les poser sur sa guitare rutilante et faire tendre
Hoodoo vers son acmé. Scintillement-trois secondes de plaisir et ça finit comme ça a commencé. Tiens, la voix hésite.
Et tout ressurgit d'un coup : les chevaux, les lasers, le castrat, les trompettes, les guitares violentées un coup par devant (reverb+tremolo) un coup par derrière (fuzz au floyd), le batteur qui s'affole, la technologie synthétique dernier cri de 1978, des sons froids comme l'acier des armures. Tout est aspiré par l'entonnoir Muse. On malaxe, on broie, on mixe. Le résultat déclare que personne ne le prendra vivant. Immortel peut-être ? Histoire d'effacer les derniers doutes, il s'en va se régénérer en violant la Vierge de Fer qui passait par là, innocemment. Métissé du sang d'Eddie the Head, cette cavalcade prend fin sur un riff surpuissant sur lequel on attend encore Bruce Dickinson.
Et de s'évanouir brutalement, bout de l'entonnoir. C'était
Knights of Cydonia.
*
Black holes and revelations. Le quatrième Muse. 45 minutes. Idéal pour qu'on ait aussitôt envie de le remettre sur la platine. Il faut se faire violence. Non on attendra.
Ce disque a réveillé en moi les sentiments de la découverte d'
Origin of symetry, quand j'entendais un groupe qui s'assumait pour le mieux, cherchait à s'extirper d'un carcan indé certes confortable mais vis-à-vis duquel ils avaient fait montre d'un peu trop de complaisance. Le monstre Muse est humain, il fallait tuer le père.
Cette fois, le carcan ils l'ont explosé, emiétté, piétiné et s'il reste des morceaux, ils n'hésiteront pas à les éparpiller de sorte qu'ils ne se retrouvent jamais.
Muse a enfin saisi son potentiel.
En exclusivité le vrai titre de cet album : "Même pas peur !"
P.S : oui oui ça va, ne vous inquiétez pas pour moi.
Dis donc c'est bien, tu as digéré tous les clichés possibles du monde de la critique musicale. Et puis c'est bien péremptoire comme il faut... On s'en que tu t'y connais.
Plus sérieusement, j'écoute parallèlement "The Eraser" de Thom et je me dis qu'il y a quand même d'autres façons d'utiliser les machines que de faire de la techno-jeux-video. Sur un détail, je reproche à Muse une utilisation excessive des montés-descentes-montés-descentes synthétiques qui marchent assez bien sur Bliss ( bien qu'au début on a un peu peur) mais placés à tout bout de champ.